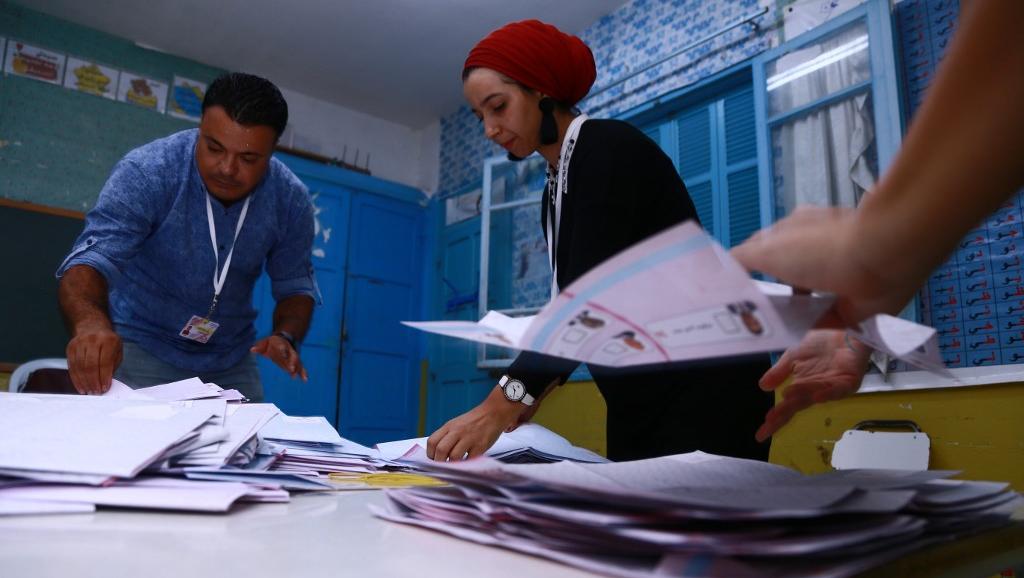— Les pays en développement doivent radicalement accroître l’innovation agricole et l’utilisation de la technologie par les agriculteurs pour éliminer la pauvreté, répondre à la demande croissante de denrées alimentaires et surmonter les effets négatifs du changement climatique. C’est le constat d’un rapport de la Banque mondiale publié aujourd’hui sous le titre Harvesting Prosperity : Technology and Productivity Growth in Agriculture.
La stagnation relative de la productivité agricole durant les dernières décennies, particulièrement en Asie du Sud et en Afrique où vit la grande majorité des populations pauvres, montre combien il est nécessaire de trouver de nouvelles idées pour améliorer les moyens de subsistance en milieu rural. D’après le rapport de la Banque, la relance de l’investissement dans l’accroissement et l’adoption de nouvelles connaissances pourrait contribuer à engendrer de substantiels gains de productivité agricole, donc de revenus.
Les auteurs du rapport constatent que près de 80 % des populations extrêmement pauvres de la planète vivent en zone rurale et que nombre d’entre pratiquent l’agriculture. En conséquence, la lutte contre la pauvreté doit être fortement axée sur l’augmentation de la productivité agricole, qui a plus d’impact que n’importe quel autre secteur sur la réduction de la pauvreté — environ deux fois plus que l’industrie manufacturière.
« En stimulant la productivité dans le secteur agricole, il est possible de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité tout en permettant à un plus grand nombre de personnes de quitter la ferme pour pratiquer d’autres activités en ville. Cette démarche exige une réforme générale des systèmes nationaux d’innovation agricole, une plus grande efficacité des dépenses publiques et le développement de chaînes de valeur agricoles inclusives dans lesquelles le secteur privé joue un rôle accru », estime Ceyla Pazarbasioglu, vice-présidente pour les questions de croissance équitable, de finance et d’institutions à la Banque mondiale. « Les nouvelles technologies améliorent l’accès à l’information, aux financements et aux services d’assurance — tout en réduisant leur coût — dans tous les secteurs, y compris le secteur agricole. Cette approche peut contribuer à améliorer la productivité des exploitants agricoles peu qualifiés, mais seulement avec les capacités et les mesures d’incitation nécessaires pour développer ces technologies et les appliquer à grande échelle. »
Le rapport examine les éléments moteurs et les obstacles en matière de productivité agricole et formule des conseils pragmatiques sur l’action à mener. Selon ses auteurs, alors que les rendements de culture ont sextuplé en Asie de l’Est durant les 40 dernières années et ont ainsi contribué à la réduction spectaculaire de la pauvreté en Chine et dans d’autres pays d’Asie de l’Est, ils ont seulement doublé en Afrique subsaharienne et dans certaines régions d’Asie du Sud, où, en conséquence, la réduction de la pauvreté a été décevante.
De surcroît, le changement climatique et la détérioration des réserves de ressources naturelles affecteront durement l’agriculture, en pénalisant les populations pauvres et vulnérables, précisément en Afrique et en Asie du Sud.
L’adoption de technologies et méthodes innovantes par les agriculteurs est le principal moteur de l’amélioration de la productivité agricole et de la hausse des revenus. Cette approche permettra aux agriculteurs d’accroître les rendements, de gérer les intrants de façon plus efficiente, d’adopter de nouvelles cultures et de nouveaux systèmes de production, d’améliorer la qualité de leurs produits, de préserver les ressources naturelles et de s’adapter aux dysfonctionnements climatiques.
Le monde est toutefois confronté à des écarts croissants en matière de dépenses de recherche et développement (R&D), bien que le financement public de l’agriculture atteigne de nouveaux sommets. En 2011, l’investissement dans la R&D agricole correspondait à 3,25 % du PIB agricole dans les pays développés contre 0,52 % dans les pays en développement. Parmi ces derniers pays, le Brésil et la Chine ont investi des montants relativement élevés dans la R&D agricole, mais l’Afrique et l’Asie du Sud affichaient le plus bas niveau de dépense par rapport au PIB agricole. En fait, les dépenses de recherche-développement sont en recul dans la moitié des pays africains.
Les pouvoirs publics doivent prendre en considération à la fois la recherche publique et privée et le transfert de technologie pour renforcer leur système global d’innovation La réorientation de l’aide publique actuelle à l’agriculture est l’occasion de revitaliser les systèmes publics de recherche agricole, d’investir dans l’enseignement supérieur agricole et de mettre en place les conditions nécessaires à la mobilisation de la R&D du secteur privé. Pour sa part, le secteur privé peut accélérer l’accès des agriculteurs aux nouvelles technologies. Les entreprises privées contribuent à environ la moitié des dépenses totales de R&D axées sur les besoins des agriculteurs dans les pays développés et jusqu’à un quart dans les grandes économies émergentes telles que la Chine, l’Inde et le Brésil. En matière de politiques et de réglementation, il existe plusieurs façons d’encourager l’accroissement de la R&D privée dans l’agriculture : réduction des entraves à la participation au marché, mesures visant à favoriser la concurrence, suppression des réglementations coûteuses et renforcement des droits de propriété intellectuelle.
« En Afrique et en Asie du Sud, l’agriculture est confrontée à un paradoxe sur le plan de l’innovation. Alors qu’il est prouvé que la R&D et la diffusion des connaissances ont un impact très élevé sur les rendements et la croissance économiques, les dépenses de recherche diminuent dans des zones critiques du monde et les universités et centres de recherche locaux n’arrivent pas à suivre. Les responsables de l’action publique des pays en développement doivent prêter une attention toute particulière à la nécessité de renverser ces tendances et créer des conditions générales plus favorables pour encourager aussi la contribution du secteur privé », déclare William Maloney, économiste en chef à la Banque mondiale pour les questions de croissance équitable, de finance et d’institutions, qui est aussi le principal auteur du rapport.
Les nouvelles technologies de communication rendent l’accès à l’information, aux financements et aux services d’assurance plus aisé que dans le passé, mais les petits agriculteurs se heurtent à des obstacles considérables quand il s’agit d’adopter les nouvelles technologies que produisent ces efforts de recherche.
« La médiocrité des informations sur les nouvelles technologies, l’absence de marchés de l’assurance et des capitaux, le niveau élevé des coûts de transaction sur le marché, l’insécurité qui entoure le régime foncier et le manque d’infrastructures de transport entravent l’adoption et la diffusion de nouvelles technologies parmi les agriculteurs »,déplore Martien Van Nieuwkoop, directeur au Pôle mondial d’expertise en agriculture et alimentation de la Banque mondiale. « Outre l’accroissement des dépenses de R&D, il est nécessaire de déployer des efforts soutenus pour éliminer ces obstacles ».
Le rapport« Récolter la prospérité : technologie et productivité dans l’agriculture » est le quatrième volume de la série d’études du Projet sur la productivité de la Banque mondiale. Ces travaux examinent le « paradoxe de la productivité » que constitue le ralentissement persistant de la croissance de la productivité en dépit des progrès technologiques. Pour consulter le rapport et les produits connexes (en anglais) :