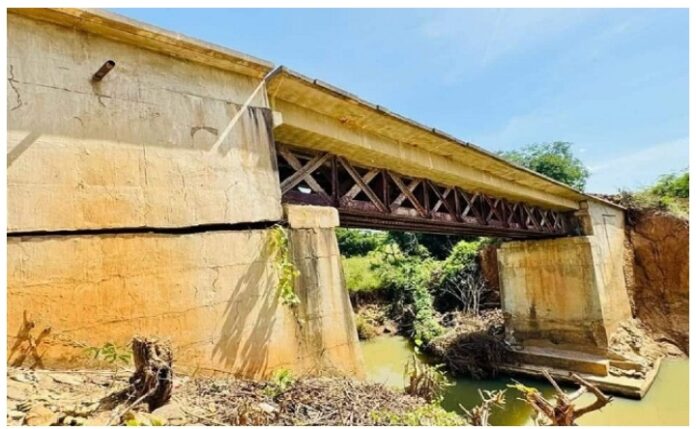(CROISSANCE AFRIQUE)-Au Mali, le gouvernement a annoncé une majeure découverte d’un gisement de lithium estimé à 21, 31 millions de tonnes, le mercredi 16 Avril 2025. Cette annonce constitue un tournant significatif pour l’industrie minière du pays.
Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret autorisant le transfert à la Société Les Mines de Lithium de Bougouni-S.A. du permis d’exploitation de grande mine de lithium, précédemment attribué à la Société Future Minerals-SARL, à Foulaboula, dans le Cercle de Bougouni, Région de Bougouni.
Ce transfert est le résultat d’un processus rigoureux de recherche et d’exploration, qui a mis en lumière le potentiel immense de la région en matière de ressources lithium, un minéral clé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques et autres technologies durables.
« Un permis de recherche pour le lithium et les substances minérales du groupe 2 a été attribué à la Société Future Minerals-SARL à Foulaboula. Les travaux de recherche, menés par la Société sur le périmètre de Foulaboula, ont permis de découvrir un gisement de lithium avec des réserves estimées à 21,31 millions de tonnes à une teneur de 1,11% d’oxyde de lithium, exploitable par la méthode conventionnelle à ciel ouvert sur une durée de 10 ans, » a déclaré le communiqué du conseil des ministres tenu le 16 Avril 2025.
Cette découverte ne se limite pas à des chiffres impressionnants, mais évoque également le potentiel de développement économique pour la région et le pays. Le gouvernement prévoit que cette exploitation minière pourrait créer des milliers d’emplois, stimuler l’économie locale et améliorer les infrastructures environnantes.
Suite à cette découverte, un permis d’exploitation de grande mine de lithium a été attribué à la Société Future Minerals-SARL, par le Décret n°2021-0774/PM-RM du 05 novembre 2021. Le gouvernement explique qu’en application des dispositions du Code minier, la Société Future Minerals-SARL a créé la Société d’exploitation anonyme de droit malien dénommée « Les Mines de Lithium de Bougouni-S.A. ».
Ce changement de propriétaire n’est pas simplement une formalité bureaucratique ; il reflète une stratégie plus large pour attirer des investissements étrangers tout en s’assurant que les bénéfices de l’exploitation minière profitent avant tout aux Maliens.
Notons que le projet de décret, récemment adopté, autorise le transfert au profit de la Société Les Mines de Lithium de Bougouni-S.A. du permis d’exploitation de grande mine de lithium attribué à la Société Future Minerals-SARL, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l’exploitation des ressources naturelles du Mali.
Pour rappel, ce développement pourrait également repositionner le pays sur la carte mondiale des exportateurs de minéraux stratégiques, en réponse à la demande croissante pour des matériaux nécessaires à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique.
Daouda Bakary KONÉ