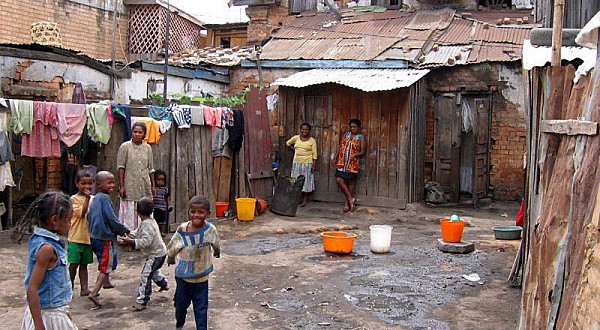par la rédaction
Le groupe Air France-KLM a enregistré au premier trimestre une perte nette de 1,8 milliard d’euros, la pandémie de Covid-19 ayant fortement impacté sa performance depuis mars après un bon début d’année. Le trafic passager a reculé de 20,1% et la recette unitaire de 6,9%, tandis que la reprise sera « lente » à partir de l’été.
Comme annoncé en février, l’impact de la crise sanitaire sur les résultats financiers du groupe franco-néerlandais est brutal : chiffre d’affaires en recul de 15,5% à 5,02 milliards d’euros (baisse de 922 millions), résultat d’exploitation à -815 millions d’euros, et marge d’exploitation ayant chuté de 11,4 point à -16,2%. La baisse du résultat d’exploitation de 529 millions d’euros par rapport à l’année dernière est « entièrement causée par le résultat d’exploitation de mars 2020 à -560 millions d’euros » suite à l’immobilisation de la quasi-totalité de la flotte, précise Air France-KLM dans son communiqué de jeudi matin.
Le résultat net s’élève à -1801 millions d’euros, soit une baisse de 1477 millions d’euros par rapport à la même période en 2019 : cela prend en compte « des éléments exceptionnels dus au Covid-19 » : la dépréciation de huit Boeing 747 pour -21 millions d’euros, l’amortissement accéléré des Airbus 380 pour -25 millions d’euros, la « surcouverture » carburant pour -455 millions d’euros, et un impact d’’impôts pour -173 millions d’euros.
Le coût unitaire du premier trimestre 2020 a augmenté de 3,5%, principalement en raison des réductions de capacité liées à Covid-19 ; à taux de change et prix du carburant constants, les coûts unitaires ont augmenté de 3,5% au premier trimestre. Les coûts salariaux nets du groupe ont diminué de 2,8% en 2020 par rapport à l’année dernière, « grâce à la mise en œuvre de l’activité partielle à Air France au cours des deux dernières semaines de mars 2020, au non renouvellement des contrats temporaires et à l’absence de dispositions de participation aux bénéfices dans les deux compagnies ». Le nombre moyen d’ETP (équivalent temps plein) au premier trimestre 2020 a augmenté de 600 par rapport à l’année dernière, dont 450 pilotes et 450 membres d’équipage de cabine supplémentaires.
| Résultat d’exploitation Groupe Air France (€m) | -536 | -287 |
| Marge d’exploitation (%) | -17,80% | -11,0 pt |
| Résultat d’exploitation Groupe KLM (€m) | – 275 | – 228 |
| Marge d’exploitation (%) | -12,9% | -10,9 p |
Benjamin Smith, DG du groupe Air France-KLM, a déclaré : « Le groupe a réalisé un début de premier trimestre prometteur, en ligne avec les objectifs du plan stratégique présenté en Novembre 2019. Cependant, l’accélération de la crise du Covid-19 en mars a fortement impacté les résultats du groupe au premier trimestre. Je remercie nos équipes pour leur mobilisation exceptionnelle dans cette crise sans précédent. Le groupe Air France-KLM s’est adapté rapidement, par la mise en place de mesures de sécurité sanitaire indispensables à nos personnels et à nos clients, la réduction de nos coûts pour préserver nos liquidités, l’ajustement continu de notre programme de vols, ou encore les nombreux vols de rapatriement et de transport de matériel médical ». Des incertitudes demeurent sur l’évolution du Covid-19 « et nous invitent à être prudents dans les hypothèses de reprise des prochains mois », a-t-il ajouté.
L’engagement des gouvernements français et néerlandais à soutenir financièrement le groupe ainsi que le fait que nos banquiers participent à ces programmes, témoignent fortement de leur confiance dans notre capacité à surmonter cette crise et à nous reconstruire. Nous travaillons sur un nouveau plan pour que le groupe Air France-KLM retrouve sa compétitivité dans un monde profondément bouleversé et réaffirme son leadership dans la transition durable du transport aérien. Ces nouvelles orientations seront présentées dans les prochains mois.
Face au niveau d’incertitude élevé sur la durée de la crise du Covid-19 et son impact sur l’environnement macro-économique, Air France-KLM retire ses perspectives antérieures pour 2020, et prévoit désormais :
- Une lente reprise de l’activité à l’été 2020, avec la levée progressive des restrictions aux frontières, avec une capacité d’environ -95% pour le deuxième trimestre 2020 et -80% pour le troisième trimestre 2020 par rapport à l’année dernière ;
- Un impact négatif prolongé sur la demande passage, qui ne devrait pas revenir au niveau d’avant la crise avant plusieurs années ;
- Un repositionnement de la flotte incluant une réduction structurelle de la capacité d’au moins -20% en 2021 par rapport au niveau d’avant la crise de 2019.
Par ailleurs le groupe prévoit un EBITDA significativement négatif sur 2020 et une perte au niveau du résultat d’exploitation nettement plus élevée au deuxième trimestre qu’au premier trimestre 2020. Le Groupe va donc « élaborer un nouveau plan de transformation pour assurer la viabilité économique et financière à moyen et long terme, avec l’intégration de nouveaux objectifs environnementaux ambitieux ».