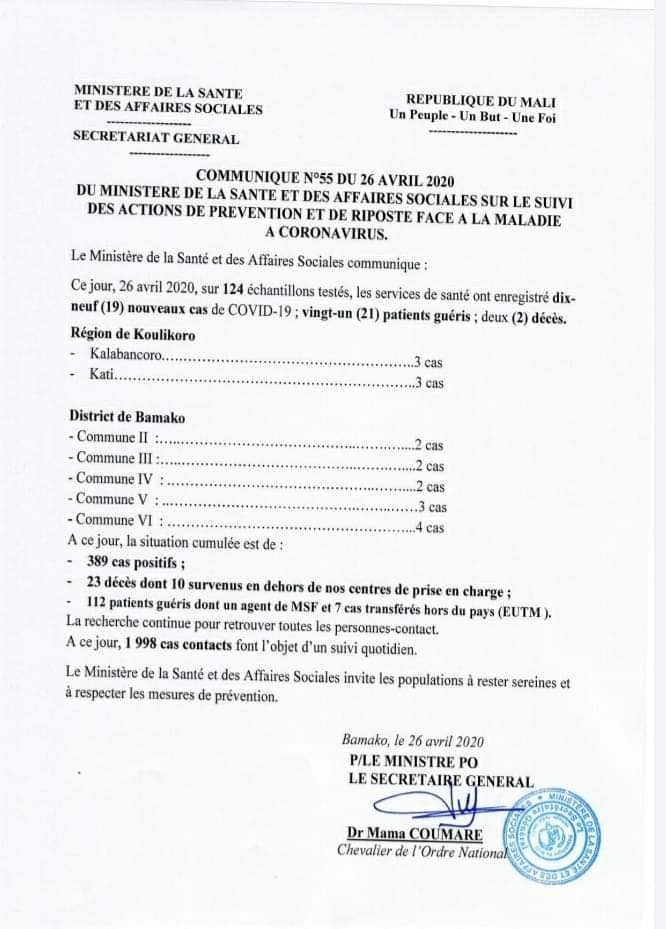Alors que l’Union africaine (UA) et l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) viennent de s’entendre pour développer des solutions innovantes en matière d’énergies renouvelables afin d’améliorer l’accès à l’énergie électrique sur le continent notamment en milieu rural, l’African Energy Chamber, basée en Afrique du Sud, a fait paraitre hier un communiqué faisant valoir l’énergie nucléaire comme étant « l’une des options les plus attrayantes lorsqu’on envisage une source d’énergie propre, fiable et rentable ».
Mais tout d’abord, revenons à l’accord entre l’UA et l’Irena. L’Irena qui soulignait, en octobre dernier dans son Global Renewable Outlook, qu’un investissement planétaire de $ 130 000 milliards d’ici 2050 permettraient non seulement de créer 78 millions d’emplois mais réduiraient au minimum de 70% des émissions de gaz à effet de serre à cette échéance.
S’agissant de l’Afrique, où 600 millions de personnes sont sans accès à l’électricité, les énergies renouvelables permettraient d’alimenter les centres de santé -préoccupation première en cette période de Covid19- mais aussi les communautés rurales notamment pour aider à pomper l’eau, base de l’hygiène. « Notre réponse à cette crise doit également promouvoir le développement durable à long terme« , a déclaré Francesco La Camera, le directeur général de l’Irena, rapporte Afrik21. L’UA et l’Irena collaboreront à créer des corridors d’énergies propres notamment en Afrique de l’Ouest.
La prochaine étape énergétique
Du côté de l’African Energy Chamber (AEC), on s’interroge sur « la prochaine étape pour l’Afrique » en matière d’énergie, avançant fortement la solution de l’énergie nucléaire. « Alors que le continent a connu de grandes réalisations dans les développements pétroliers et gaziers et a vu le lancement de nombreux programmes d’énergies renouvelables réussis, mettant en ligne des projets de classe mondiale à grande échelle, il n’a toujours pas réussi à combler son fossé énergétique« , souligne l’organisation basée en Afrique du Sud et qui fournit la réponse : » L’énergie nucléaire est l’une des options les plus attrayantes lorsqu’on envisage une source d’énergie propre, fiable et rentable« , rappelant aussi que l’Afrique du Sud est le seul du continent à posséder une centrale nucléaire commercialisée.
L’Egypte abrite, elle, l’un des plus anciens programmes électronucléaires, souligne le communiqué. Lancé en 1954, le programme est responsable de la centrale nucléaire de 4,8 GW d’El Dabaa, actuellement en phase de construction. Le projet sera développé par la Russian State Atomic Energy Corporation (Rosatom). La compagnie russe est le plus grand acteur de l’énergie nucléaire en Afrique, ayant conclu des protocoles d’accord avec le Nigeria, le Kenya, le Soudan, la Zambie et l’Ouganda, souligne le communiqué.
Le premier réacteur nucléaire du Kenya devrait être achevé en 2027, tandis que l’accord intergouvernemental de 2019 entre l’Ouganda et Rosatom pour aider à développer l’infrastructure nucléaire est toujours en vigueur.
En revanche s’agissant du Sénégal, le communiqué de l’AEC sème un doute. En effet, l’AEC souligne que Dakar aurait « partagé plus tôt cette année sa disponibilité pour l’énergie nucléaire« , citant Ndèye Arame Boye Faye, directeur général l’Autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nucléaire (ARSN) : « Avant l’INSSP [Plan intégré d’appui en matière de sécurité nucléaire du Sénégal, ndlr], nous ne considérions pas la sécurité nucléaire comme un problème qui affectait notre pays, car nous n’avions pas de programme électronucléaire. En coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, nous travaillons à évaluer les menaces « .
Cette citation est tirée d’un communiqué daté du 26 mars 2020 de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), basée à Paris, évoquant le plan du Sénégal, élaboré en collaboration avec l’AIEA, pour renforcer les compétences de l’ARSN dans le domaine de la sécurité nucléaire. « Les mesures de sécurité nucléaire visent principalement à prévenir, à détecter et à contrer des utilisations malveillantes de matières radioactives, telles que les actes de terrorisme nucléaire« , souligne le communiqué de l’AIEA. » Le but ultime étant de prévenir les dommages que peuvent causer les rayonnements ionisants quand des matières radioactives tombent entre de mauvaises mains« . Il ne s’agit donc pas, apparemment, pour le Sénégal d’envisager de recourir à l’énergie nucléaire mais plutôt de se protéger.
Mais revenons à l’énergie nucléaire comme solution mise en avant par l’African Energy Chamber pour résoudre le défi énergétique titanesque du continent. Ceci dit, même la Chambre est consciente du facteur temps, mais vraiment du long terme…. « Un programme électronucléaire réussi nécessite un large soutien politique et populaire et un engagement national d’au moins 100 ans », selon Miliko Kovachev, chef de la Section du développement des infrastructures nucléaires de l’Agence internationale de l’énergie atomique cité dans le communiqué de l’AEC. En revanche, les réacteurs nucléaires à petite échelle (300 MWe ou moins) seraient une solution alternative, pouvant être rapidement mise en oeuvre.
L’autre défi est le financement, convient aussi la Chambre dans son communiqué mais elle y apporte une solution. « Il existe des mécanismes de financement comme, par exemple, des agences d’exportation des pays fournisseurs. Exploiter un approvisionnement énergétique fiable et décarboné lorsque les fournisseurs proposent de le financer peut avoir du sens pour plusieurs pays d’Afrique« , soulignerait encore Miliko Kovachev.
Notons que l’AEC travaille avec une centaine d’entreprises en Afrique de l’Ouest, principalement des entreprises locales et dans le domaine des services liés aux énergies.