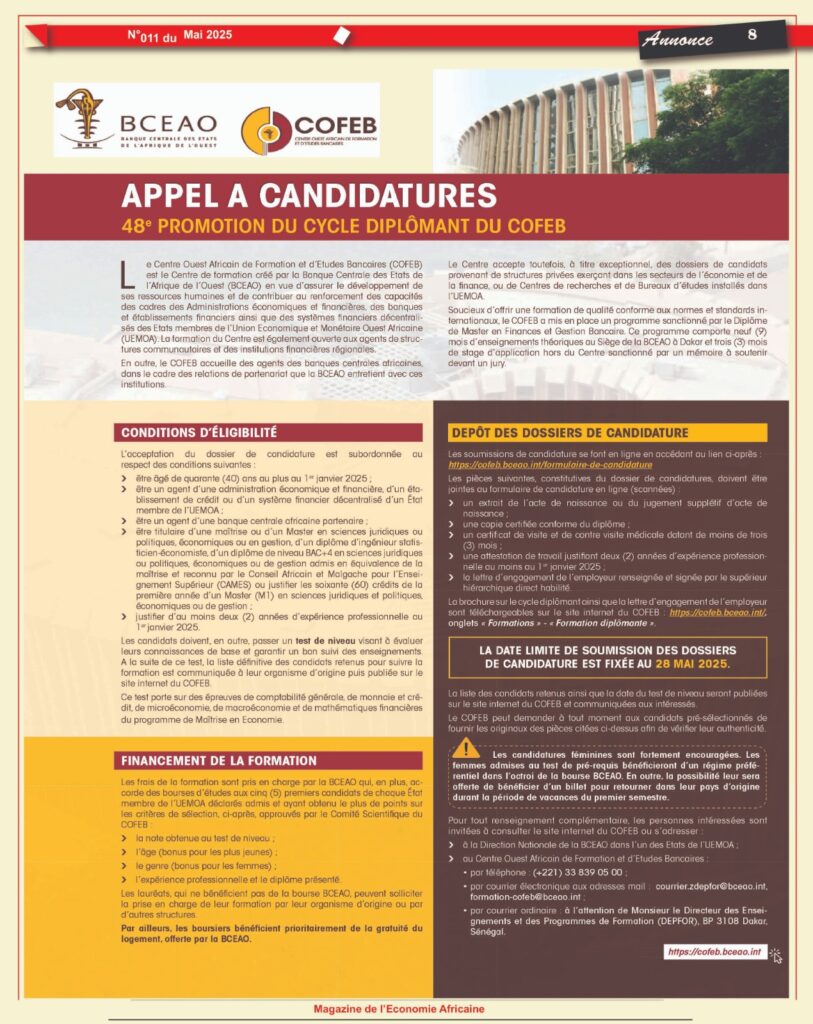À Bamako, sous les projecteurs et derrière les micros, quelques visages bien connus de la scène politique malienne multiplient les conférences de presse et les appels à manifester. Officiellement, ces jeunes leaders affirment lutter pour la démocratie. Officieusement, ils ont une volonté plus obscure : servir des intérêts étrangers, au premier rang desquels ceux de la France.
Depuis Paris, plusieurs activistes maliens en exil ; soutenus discrètement mais efficacement par les autorités françaises ; s’agitent sur les réseaux sociaux. Avec l’appui logistique et médiatique des chancelleries occidentales, en particulier du Quai d’Orsay, ces derniers cherchent à créer les conditions d’un soulèvement populaire au Mali. L’objectif inavoué ? Fragiliser les autorités de la transition afin de permettre aux groupes terroristes, repoussés depuis le départ de la Minusma et de Takuba, de regagner du terrain.
Un vieux scénario en boucle
Ce scénario nest pas nouveau. Déjà sous Modibo Keita, le premier président du Mali indépendant, la France avait orchestré son éviction en 1968 en misant sur des relais locaux. Plus tard, cest Moussa Traoré qui subira le même sort, dans des circonstances également troubles. À chaque fois, l’histoire retiendra un schéma identique : une contestation intérieure encouragée, financée ou instrumentalisée par des puissances extérieures, aboutissant à un changement de régime favorable aux intérêts français.
Aujourd’hui encore, ce sont ces mêmes mécanismes qui semblent être à l’œuvre. Ces nouveaux « porte-voix de la démocratie » sont avant tout les visages d’un agenda néocoloniale mal dissimulé. Les discours sont rodés, les slogans aguicheurs, mais les véritables objectifs sont ailleurs : réinstaller un système favorable à Paris, restaurer la présence militaire et économique française dans le Sahel, et reprendre le contrôle dune région stratégique.
Des relais bien établis et une propagande bien huilée
Les médias français, notamment ceux du groupe France Médias Monde, jouent un rôle central dans cette entreprise. Alors que Radio France Internationale (RFI) est suspendue au Mali, elle continue de couvrir avec zèle les moindres faits et gestes de l’opposition malienne. Pour une seule conférence de presse tenue à Bamako, RFI a publié jusqu’à six articles, allant jusqu’à organiser plusieurs débats sur la « chute probable » du régime malien actuel.
Les chaînes françaises amplifient ces voix dissidentes, ignorent les avancées réalisées dans le cadre de la souveraineté retrouvée du pays, et ferment les yeux sur la fragilité que ces initiatives font peser sur le processus de paix au Mali. Car en réalité, une instabilité accrue à Bamako ne profite quà ceux qui veulent voir le pays replonger dans le chaos. Tel est malheureusement le cas de certains cadres politiques ayant déjà été ministres et même Premier ministre. D’autres, des journalistes exilés, ont d’ailleurs opté pour la désinformation pour mobiliser la foule. Donc des anciennes images de manifestations sur le boulevard de L’indépendance et des anciennes sorties de limam Mahmoud Dicko sont publiées dans l’unique dessein de mobiliser la foule.
Une menace pour la paix régionale
Ce mouvement en gestation, mêlant politiciens opportunistes, activistes en exil et journalistes renégats, ne vise pas à instaurer une véritable démocratie. Il sagit plutôt dun coup de force politique déguisé, destiné à faire tomber un régime pour mieux en installer un autre, dirigé par les mêmes visages qui ont longtemps fait le jeu de Paris.
L’expérience libyenne est encore fraîche. La chute de Kadhafi, orchestrée avec l’appui de la France, a transformé ce pays en un foyer de déstabilisation pour toute la sous-région. Aujourdhui, cest le Soudan qui vit une tragédie similaire : un conflit armé entre factions rivales sur fond d’ingérence étrangère. Le Mali ne peut se permettre de suivre ce chemin.
Vigilance et souveraineté
L’heure est à la vigilance. Loin des discours enjolivés, les Maliens doivent se poser les bonnes questions : à qui profite vraiment cette agitation politique ? Quels intérêts défendent réellement ces prétendus leaders démocrates ? Pourquoi certains activistes publient-ils des centaines d’appels à la mobilisation depuis leur confort français ? Pourquoi ne viennent-ils pas manifester sur le boulevard eux-mêmes ? La paix, la sécurité et l’unité du Mali ne peuvent être sacrifiées sur l’autel des ambitions personnelles ni des calculs géopolitiques d’anciennes puissances coloniales.
Notons que le Mali, à l’instar des autres pays de l’AES, a entamé un processus de reconquête de sa souveraineté. Ce combat doit se poursuivre sans relâche. La démocratie ne se construit pas dans la manipulation, mais dans le respect de la volonté du peuple, libre de toute ingérence extérieure.