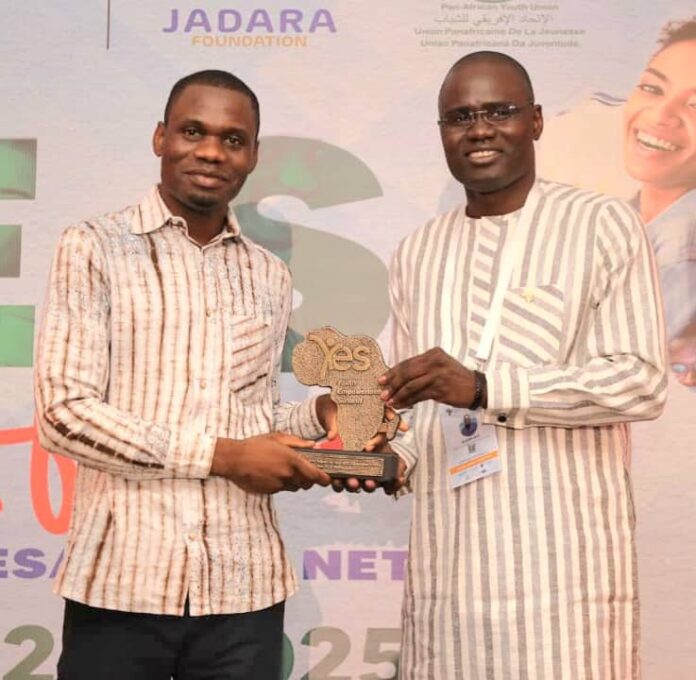Par Harouna Niang
Ancien Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements du Mali
« On ne construit pas une économie forte avec des accords faibles. »
Alors que l’Afrique cherche à sortir du piège de la pauvreté et de la dépendance, une vérité s’impose de plus en plus : nos accords commerciaux sont trop souvent déséquilibrés, et parfois même destructeurs pour nos industries locales. Il est temps pour l’Afrique de renégocier avec fermeté ces engagements pour les aligner sur ses objectifs de souveraineté économique, d’industrialisation et de développement humain.
1)Des accords signés trop vite, souvent au détriment des intérêts nationaux
Au fil des décennies, de nombreux accords bilatéraux ou multilatéraux ont été signés entre les pays africains et des partenaires extérieurs: Union européenne, Chine, États-Unis, ou encore les institutions financières internationales. Derrière la rhétorique de la coopération, plusieurs de ces textes ont conduit à :
• Une ouverture commerciale prématurée, exposant nos industries naissantes à une concurrence féroce et souvent déloyale qui freine même la création de nouvelles industries;
• Une perte massive de recettes fiscales douanières, grevant les budgets publics (dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, les droits de douane représentent encore jusqu’à 30 % des recettes fiscales selon la CNUCED) ;
• Un accès limité aux marchés extérieurs pour nos produits transformés ;
• Une captation de la valeur ajoutée par des firmes étrangères, laissant peu de retombées locales notamment au niveau du nécessaire transfert de technologie et know-how.
Le cas des Accords de Partenariat Économique (APE) proposés par l’Union européenne est emblématique. Ces accords prévoyaient la suppression progressive des droits de douane africains sur 80 % des produits européens, sans offrir de garanties concrètes sur la protection de nos secteurs stratégiques. Selon une étude de la Commission économique pour l’Afrique (CEA, 2017), les APE dans leur version initiale auraient pu entraîner une perte de 1,1 milliard de dollars de recettes douanières par an pour les pays africains signataires.
Le Nigeria, dans un geste souverain, a refusé de signer l’APE régional de la CEDEAO, en dénonçant son potentiel de « désindustrialisation massive ». D’autres pays, comme le Sénégal et le Ghana, ont signé mais tardé à ratifier, face à la pression des acteurs économiques.
Preuve qu’une autre voie est possible.
2) Des ressources bradées, des infrastructures importées : l’exemple congolais
Un autre exemple frappant vient de la République Démocratique du Congo. En 2008, elle signait un « contrat chinois » : échange de cobalt et cuivre contre routes et hôpitaux, pour un montant total de 6 milliards de dollars. Ce contrat dit « Sicomines » a été largement critiqué pour son manque de transparence et l’absence d’obligations fermes de livraison d’infrastructures.
D’après un rapport de l’Inspection Générale des Finances de la RDC (2023), la Chine aurait investi à peine 822 millions de dollars en infrastructures au cours des 15 années suivant la signature, alors que les revenus tirés des minerais dépassaient 3,5 milliards USD. Les entreprises congolaises, elles, ont été presque totalement exclues de la chaîne de valeur.
En 2023, le président Tshisekedi a exigé la renégociation du contrat, réclamant un meilleur partage des revenus (passage des redevances de 0,3 % à 1,2 %), plus de contenu local et une transparence accrue. Cette décision a été saluée par la Banque africaine de développement (BAD) comme un exemple de souveraineté économique assumée.
3) Ce que doit faire l’Afrique
3.1 Mener un audit complet de ses accords commerciaux : quels sont les avantages réels ? Quels sont les préjudices subis ? Quels secteurs doivent être mieux protégés ? (Cf. rapport ICTSD, “Making Trade Work for Africa’s Industrialization”, 2018)
3.2 Inclure des clauses de flexibilité et de sauvegarde : autorisant des révisions en cas de menace sur les industries locales (cf. dispositions de l’article XIX du GATT – sauvegardes générales).
3.3 Favoriser le contenu local et la transformation sur place dans les échanges de ressources (mines, agriculture, forêts).
3.4 Parler d’une seule voix au niveau régional, via la ZLECAf, pour peser davantage. La CEA estime que si elle est bien mise en œuvre, la ZLECAf pourrait faire croître le commerce intra-africain de 52 % d’ici 2027.
3.5 Renforcer les capacités des négociateurs africains : seule une expertise renforcée permet d’éviter les clauses défavorables (cf. formation de la “Trade Policy Training Centre in Africa”, TPTCA – Arusha).
4) Redonner du sens à l’intégration régionale
L’Afrique ne peut se développer si elle reste un simple marché pour les autres. La ZLECAf représente une opportunité historique de rompre avec les anciennes logiques de dépendance. Mais cela suppose que les pays africains harmonisent leurs politiques industrielles, investissent dans les infrastructures régionales, et créent des champions industriels communs.
Surtout, la mise en œuvre effective de la ZLECAf doit impérativement s’accompagner de mécanismes de compensation et de solidarité, pour corriger les déséquilibres et inégalités entre les pays africains, notamment entre les économies les plus avancées et les plus fragiles. Sans cela, le risque est réel que certains pays soient marginalisés ou deviennent des marchés de consommation sans base productive. Un fonds d’ajustement régional, financé par une partie des gains issus du commerce intra-africain ou des contributions mutualisées, pourrait atténuer les chocs et financer l’industrialisation des pays les moins avancés (cf. UNCTAD, “Economic Development in Africa Report”, 2021).
Comme le rappelle le Rapport 2023 de la Banque mondiale, les chaînes de valeur intra-africaines sont celles qui génèrent le plus d’emplois et de transformation locale (bien plus que le commerce Afrique–Europe ou Afrique–Asie.)
- Conclusion : Souveraineté économique ou dépendance renouvelée ?
Renégocier nos accords commerciaux, ce n’est pas se fermer au monde. C’est s’ouvrir à des partenariats équilibrés et porteurs de transformation structurelle. C’est dire à nos partenaires : nous voulons commercer avec vous, mais pas au prix de notre avenir.
L’Afrique a trop longtemps été un continent de promesses non tenues. Il est temps que nos accords commerciaux deviennent des leviers de développement, et non des chaînes de soumission.
H. Niang