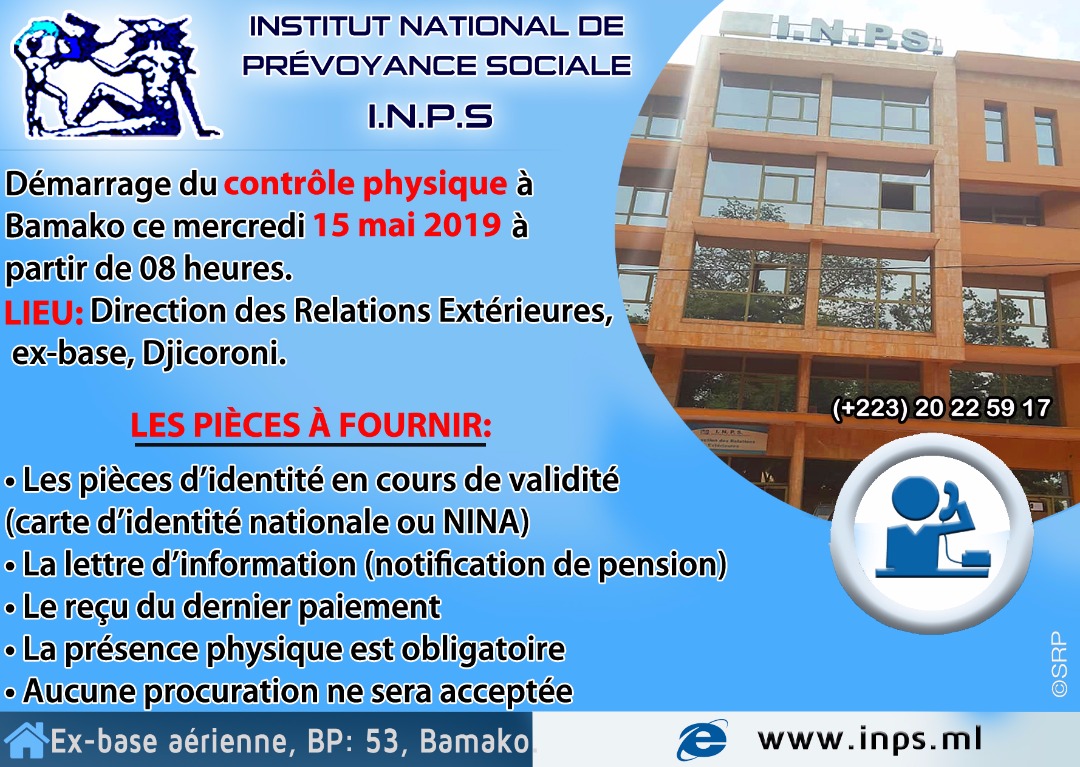(Ecofin Hebdo) – En Tanzanie, la construction de la centrale hydroélectrique de Stiegler Gorge, qui semble être devenue pour le chef de l’Etat une question de fierté personnelle, risque fort de finir en éléphant blanc. Mais il aura réussi au passage l’exploit de saccager une bonne partie des ressources forestières du pays. D’une capacité de 2115 MW, le barrage est l’un des projets les plus ambitieux du gouvernement de John Magufuli. Le président, que ses concitoyens surnomment (le taureau), semble sur ce dossier vouloir faire honneur à son sobriquet. En effet, divers organismes internationaux ont marqué leur réticence face à la construction d’une infrastructure qui sera implantée au cœur de la réserve naturelle de Selous Game. Elle déséquilibrera l’écosystème inscrit au patrimoine de l’Unesco, même si la commission d’étude environnementale constituée par le gouvernement affirme le contraire.
La centrale de la discorde
Le développement de l’infrastructure prévue pour une capacité de 2115 MW a débuté dans les années 2000, mais le projet très décrié par les environnementalistes, a été considérablement ralenti. Jusqu’à sa remise sur le tapis en février 2017. Et depuis, les choses se sont pour le moins accélérées. Contre vents et marées, les autorités ont procédé au choix de l’Egyptien Arab Contractor Company pour la construction de l’infrastructure. Les travaux ont démarré en février 2019.

John Magufuli fait du projet de Stiegler Gorge, une affaire personnelle.
La mise en place de la centrale représenterait un coût de 3 milliards $. Une étude menée par un collectif d’une centaine de scientifiques, affirme que ce chiffre est plus proche de 9,85 milliards $ si l’on prend en compte tous les coûts. « Pur mauvaise foi !», répondent les compagnies en charge du projet.
La mise en place de la centrale représenterait un coût de 3 milliards $. Une étude menée par un collectif d’une centaine de scientifiques, affirme que ce chiffre est plus proche de 9,85 milliards $ si l’on prend en compte tous les coûts.
Dans tous les cas, le gouvernement est prêt à financer le projet à hauteur de 30%, et à mobiliser le reste à l’extérieur. Il a récemment signé un chèque de 307 millions $ pour le début des travaux.
De nombreuses appels à la prudence, au recul et à l’abandon
La mobilisation des fonds sur financement extérieur pour la réalisation du barrage risque d’être très ardue. En effet, jusque-là, aucun des partenaires financiers sollicités pour le projet n’a donné de réponse favorable.
Pis, la Banque mondiale a fait part de son inquiétude face au projet de construction du barrage. Elle craint en effet que ce dernier n’aggrave le risque de pénurie d’eau dans la région. La banque rappelle que le pays a du mal à faire fonctionner ses centrales hydroélectriques déjà en service, à cause du manque d’eau.
La Banque mondiale craint que ce projet n’aggrave le risque de pénurie d’eau dans la région. La banque rappelle que le pays a du mal à faire fonctionner ses centrales hydroélectriques déjà en service, à cause du manque d’eau.
En 2012, l’Unesco a affirmé dans un rapport, que l’implantation de projets hydroélectriques majeurs n’est pas appropriée à l’intérieur des sites du patrimoine mondial naturel. L’institution a demandé à l’Etat de revoir le projet afin d’être en accord avec les engagements pris dans le sens de la conservation de site.

Contre vents et marées…
Selon le WWF, le barrage entraînera une accélération du phénomène d’érosion en aval et une diminution de la fertilité des sols, entre autres. En outre, le barrage violerait l’intégrité de trois autres aires protégées que sont Rufiji, Mafia et Kilwa.
« Que neni ! », répond tout simplement l’équipe de recherche environnementale que le gouvernement a engagée pour évaluer l’impact de l’infrastructure sur l’environnement. « Nos estimations ont révélé que le projet peut être mis en œuvre sans aucune forme de peur. La meilleure approche est de mettre en place des stratégies pour prévenir de tels impacts environnementaux.» a affirmé Raphael Mwalyosi, l’un de scientifiques ayant réalisé l’étude donnant le feu vert au gouvernement pour les travaux.
Des assertions qui ont déjà été contredites alors que les travaux de construction n’en sont qu’à leur début. En effet pour démarrer les travaux, le gouvernement a lancé le défrichement des forêts de la réserve. Selon Reuters, quelques 3,5 millions de mètres cubes d’arbres seront abattus et vendus. Une équipe de rangers a en outre été dépêchée dans le parc afin de protéger les équipes contre les animaux sauvages qui pourraient constituer une menace.
Un barrage pas nécessaire qui sera probablement un éléphant blanc
Dans une des études publiées sur le projet du barrage, le WWF fait part de sa surprise de voir le projet revenir à la surface. En effet, dans sa politique énergétique mise en place en 2016, le gouvernement envisageait le barrage de Stiegler Gorge comme une solution de rechange au cas où les autres projets de centrales échoueraient. Le pays a identifié un potentiel de plus de 1000 MW en énergies renouvelables, autres que l’hydroélectrique. Il a également la possibilité de construire de nombreux autres barrages moins importants, qui auraient des impacts moins graves sur ses écosystèmes naturels.

La Tanzanie revendique pourtant 1 milliard $ par an, entre 2020 et 2030 pour préserver son environnement.
En outre, le barrage risque de ne pas pouvoir fonctionner à plein régime faute d’eau. Le fleuve Rufiji qui est le plus large bassin de l’Afrique de l’Est, accueille déjà 80% des infrastructures hydroélectriques de la Tanzanie. Et son débit s’amenuise progressivement en raison des activités humaines.
Il a une capacité de 2115 MW alors que la puissance électrique installée du pays est d’actuellement 1602 MW. Une augmentation de capacité d’une telle ampleur nécessite des investissements conséquents en infrastructures de transport et de distribution électriques.
En outre, sur le plan technique, le barrage risque de poser un problème d’intégration dans le réseau électrique national. Il a une capacité de 2115 MW alors que la puissance électrique installée du pays est d’actuellement 1602 MW. Une augmentation de capacité d’une telle ampleur nécessite des investissements conséquents en infrastructures de transport et de distribution électriques. Un détail que le gouvernement, dans son désir de mettre en place la centrale, semble avoir oublié.
Un choix stratégiquement incohérent
Outre les inquiétudes environnementales, et le manque d’engouement des investisseurs, le barrage de Stiegler Gorge pose également un problème de cohérence politique.

Le débit s’amenuise progressivement en raison des activités humaines.
En effet, la Tanzanie fait partie des pays qui se sont engagés en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. La préservation des ressources forestières fait d’ailleurs partie de la contribution du pays à cette lutte, soumise en 2015 aux Nations Unies. Le pays demande d’ailleurs pour ces efforts un accompagnement financier de 500 millions $ à l’horizon 2020. Un appui qui devra passer à 1 milliard $ annuel entre 2020 et 2030.
La préservation des ressources forestières fait partie de la contribution du pays à cette lutte, soumise en 2015 aux Nations Unies. Le pays demande d’ailleurs pour ces efforts un accompagnement financier de 500 millions $ à l’horizon 2020. Un appui qui devra passer à 1 milliard $ annuel entre 2020 et 2030.
Face au déclin de la richesse nationale par habitant entre 1995 et 2014, le pays s’est en outre associé à la Banque mondiale pour mettre en place une analyse environnementale qui rendra possible une meilleure gestion des ressources naturelles et un développement plus écologique. Un document qui préconise entre autres une conservation des biodiversités terrestre et marine.
En outre, le pays, comme tout le continent, subit déjà de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Le plus intelligent serait alors de renforcer les atouts naturels dont il dispose déjà, et se s’appuyer sur cet avantage pour se développer. D’autant plus que ces atouts, que le gouvernement semble aujourd’hui dédaigner parce qu’ayant toujours fait partie du paysage, sont les éléments que le monde entier cherche aujourd’hui à développer et à promouvoir pour la survie de tous.

Pour la survie de tous.
Il ne reste plus qu’à espèrer que le projet stagne, une fois de plus, faute de financements. Et qu’il ne faudra pas 20 ou 30 ans aux bulldozers pour réaliser les conséquences desastreuses, et hélas irréversibles, de leurs activités.
Gwladys Johnson