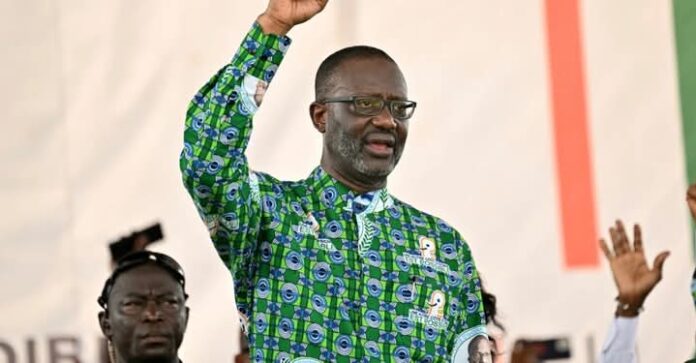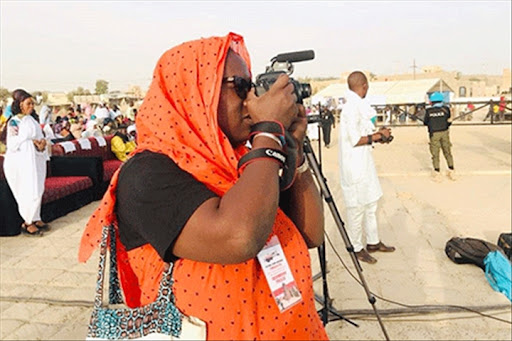(CROISSANCE AFRIQUE)-Depuis 2021, les œuvres sociales du président Assimi Goïta se sont imposées comme l’une des politiques sociales les plus visibles et les plus transformatrices du Mali contemporain.
De l’accès à l’eau potable à l’électrification solaire des hôpitaux, en passant par l’appui aux personnes vulnérables, le chef de l’État donne corps à une vision sociale inclusive et durable qui redéfinit le rôle de l’État auprès de ses citoyens. Qu’on le veuille ou non, il faudra bien un jour reconnaître au général Assimi Goïta ce que l’histoire retiendra de lui : avoir transformé la notion d’œuvres sociales d’une pratique cosmétique en un véritable levier de développement national.
Depuis quatre ans, à l’abri des projecteurs médiatiques mais au cœur des priorités présidentielles, le général d’armée malien déroule une stratégie sociale d’une ampleur inédite. Une révolution, discrète mais méthodique, qui vient redonner du sens à la promesse républicaine dans un Mali à la croisée des chemins.
Rendre l’État utile aux plus vulnérables
Tout a commencé ce 7 juin 2021, dans l’austère salle d’investiture où, loin des discours convenus, le nouveau chef de la Transition surprend son auditoire : les deux tiers de son fonds de souveraineté, cette manne d’habitude jalousement conservée par les régimes successifs, seront consacrés aux œuvres sociales. Pas de formule creuse, pas d’effet d’annonce. Une décision politique forte, traduite dans les actes, mois après mois, région après région.
Des kits alimentaires, des forages d’eau potable, des fournitures scolaires, des ambulances, des motos tricycles pour les personnes en situation de handicap, des dons aux orphelins, des soutiens directs aux femmes et aux enfants vulnérables : le catalogue des actions s’allonge. Mais Assimi Goïta n’en reste pas là. Il élève l’ambition de passer du secours d’urgence à l’investissement structurel.
Cap sur l’énergie et la santé
2024 marque un tournant. Face à une crise énergétique qui étouffe le pays, il décide de frapper fort : 25 groupes électrogènes, soit 27 mégawatts injectés dans le réseau national, pour soulager EDM-SA et apporter une réponse d’urgence au délestage. Mais surtout, il trace une nouvelle voie à travers l’électrification solaire des structures sanitaires.
En mars 2025, à Bamako, l’hôpital dermatologique bénéficie d’une centrale solaire de 400 kWh, révolutionnant la prise en charge des grands brûlés. En avril, 1 000 panneaux solaires viennent métamorphoser l’Hôpital du Mali. Un mégawatt d’énergie propre, libérant les services critiques de la dépendance au gasoil.
Le Centre national d’odontologie, le Centre de transfusion sanguine, et bientôt d’autres hôpitaux suivent la dynamique.
Dans un pays où les coupures d’électricité peuvent signer une condamnation à mort pour les patients sous oxygène, ces installations solaires ne relèvent pas de la communication. Elles sauvent des vies, améliorent durablement les conditions de travail des soignants, réduisent les coûts pour les établissements et incarnent une souveraineté énergétique naissante.
Un modèle social malien, décliné sur tous les fronts
Ce déploiement ne se limite pas à la santé. Il épouse une vision transversale où l’éducation, l’eau, la sécurité alimentaire, l’inclusion sociale et l’énergie se croisent. En effet, des centaines de forages jaillissent sur tout le territoire, du Sahel profond aux faubourgs de Bamako. Sur le plan éducatif, plusieurs écoles rurales reçoivent tables-bancs, manuels et équipements informatiques. Des écoles ont été également construites ; d’autres réhabilitées. Il faut aussi noter que les personnes handicapées reçoivent des motos adaptées, les veuves et orphelins de militaires tombés au front sont accompagnés, les producteurs, les éleveurs et les pêcheurs bénéficient aussi d’équipements et de soutiens ciblés.
A toutes ces couches, il faut ajouter que les femmes, jeunes, personnes vivant avec un handicap, paysans, citadins… chacun est visé par des actions concrètes. L’ambition est territoriale. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, aucune région n’est oubliée. Il s’agit donc d’un engagement personnel et financier inédit de la part du chef de l’État.
Rarement un président malien aura autant investi personnellement, non pas dans des discours, mais dans des actions budgétiser, traçable, évaluables. Avec les œuvres sociales, le général Assimi Goïta redonne du sens à l’argent public. Loin des pratiques clientélistes, loin des détournements de fonds. Ici, les deniers de la souveraineté sont visibles sur le terrain, palpables dans les centres de santé, les écoles, les villages, les exploitations agricoles.
Faire des œuvres sociales une politique d’État
Mais Assimi Goïta le sait. Tout cela ne saurait être une parenthèse de Transition. L’enjeu est de transformer cette dynamique en politique publique pérenne, adossée à des institutions solides, inscrite dans la durée, au-delà des hommes et des régimes.
La diversification des œuvres sociales esquisse déjà le socle d’un modèle malien de protection sociale, ancré dans la proximité, l’inclusion, l’innovation et la solidarité nationale.
Dans un Mali fracturé par les crises, les tensions et les inégalités, ce chantier social apparaît comme le fil invisible qui retisse le lien entre l’État et les citoyens. Une politique de terrain, loin des cénacles politiciens, qui s’impose comme l’un des legs majeurs d’Assimi Goïta à l’histoire du Mali.
À la croisée des crises, alors que l’AES cherche sa voie, le président malien démontre que l’État peut encore être une solution, par le social, l’énergétique et l’humain. Et si, finalement, la vraie révolution d’Assimi Goïta était là : faire du Mali, non pas seulement un pays qui se relève, mais un pays qui se soucie enfin de tous ses enfants.