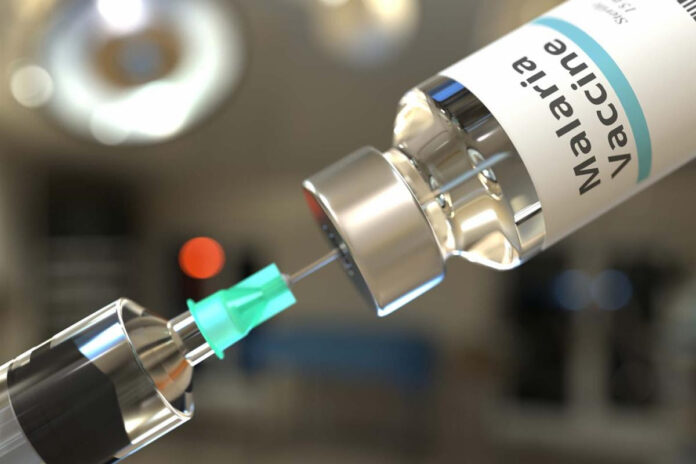(CROISSANCE AFRIQUE)-Le projet d’encadrement des fonds pétroliers est actuellement menacé par par des tensions avec les États-Unis. À deux jours de l’échéance fixée par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), le projet de remise en état des sites pétroliers pourrait subir un revers initial.
Bien que Libreville ait récemment reaffirmé sa détermination à contraindre les opérateurs à transférer ces ressources à la banque centrale, la situation régionale semble maintenant ralentir. Lors des Assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, tenues du 21 au 26 avril 2025 à Washington, la position du Cameroun, influente au sein de la Cemac, laisse planer la menace d’un report.
Louis Paul Motaze, ministre camerounais des Finances, a confié à des journalistes que, bien que les discussions se soient déroulées sans accroc, la Cemac fait face à des défis avec l’industrie extractive. Il a ajouté : “Nous avions une orientation donnée par les chefs d’État le 16 décembre. Cependant, depuis, un membre du Congrès américain a déposé un projet de loi pour entraver nos projets.”
En parallèle, alors que la délégation de la Cemac, composée du président de sa Commission et du gouverneur de la BEAC, rencontrait les représentants de l’industrie pétrolière, Louis Paul Motaze devait échanger avec le vice-président de la Banque mondiale sur cette question cruciale pour les réserves de change de la sous-région. Motaze a mentionné : “Nous avions un délai au 30 avril pour signer les conventions. Il est clair que cela ne sera pas respecté. Néanmoins, si nous pouvons au moins nous entendre sur les grandes lignes, la signature officielle pourra intervenir plus tard.”
Le retard signalé par Yaoundé dans ses négociations avec les entreprises extractives est principalement dû à la complexité des pourparlers. L’introduction d’un projet de loi au Congrès américain a récemment modifié le calendrier. Proposé par le républicain Bill Huizenga, le “Cemac Act” vise à suspendre toute aide des États-Unis aux initiatives du FMI en faveur des six pays membres de la Cemac (Cameroun, Gabon, Tchad, Congo, Centrafrique et Guinée équatoriale) tant qu’une évaluation exhaustive de leurs réserves de change n’aura pas été réalisée.
Ce projet de loi cible la BEAC, responsable des réserves, ainsi que le FMI, accusé de manquer d’exigences en matière de transparence. En cause, l’immunité souveraine revendiquée par la banque centrale régionale complique tout recours en cas de mauvaise gestion. Les parlementaires américains estiment que cette immunité est incompatible avec les normes internationales, notamment celles relatives aux réserves “rapidement mobilisables,” telles que définies par les manuels du FMI.
C’est dans ce climat de tensions que la BEAC cherche à imposer une nouvelle convention aux sociétés minières et pétrolières opérant en Afrique centrale. Cette convention, qu’elles doivent signer au plus tard le 30 avril 2025, les contraint à constituer des provisions pour la restauration environnementale des sites exploités.
Noyons que ces fonds étaient théoriquement requis depuis 2018, mais la BEAC, en accord avec les États de la sous-région, avait prévu de renforcer les mesures. À partir du 1er mai, tout opérateur qui ne signera pas la convention risque des pénalités pouvant aller jusqu’à 150 % du montant des provisions dues.
MARIAM KONE