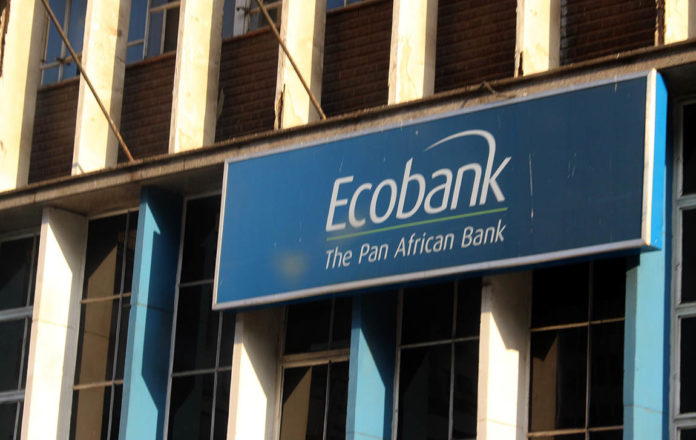(CROISSANCE AFRIQUE)-Dans la crainte de voir une éventuelle dissolution des partis politiques à l’issue de la consultation nationale des forces vives dont la phase régionale a été bouclée, certains n’hésitent pas à attribuer la paternité de l’accession à l’indépendance uniquement aux partis politiques. Certainement, qu’ils ont oublié que tout est parti des luttes syndicales qui ont pris la forme politique.
Au Mali, ne serait-ce que dans l’histoire politique récente, les syndicats ont été à l’avant-garde de l’instauration du multipartisme dans le pays. L’unique centrale syndicale de l’époque, l’UNTM (Union nationale des travailleurs du Mali) et le syndicat estudiantin, l’AEEM ( Association des élèves et étudiants du Mali), ont joué un rôle de.premier plan dans la chute du régime du parti unique de feu Général Moussa Traoré, le 26 mars 1991. D’ailleurs, c’est la grève illimitée, décrétée par ces deux organisations syndicales, qui a sonné le glas de ce régime. Reconnaissant le rôle central de la centrale syndicale dans ce combat, feu Bakary Karambé, secrétaire général de l’UNTM, a été nommé par les nouvelles autorités politiques, premier vice-président du nouvel organe dirigeant du pays qu’était le CTSP ( Comité de transition pour le salut du peuple). Il faut noter qu’avant cette période, les syndicats ont été les premiers à lutter pour l’indépendance du Mali. Ils ont donné naissance à deux grands courants politiques qui ont amené les colonies françaises d’Adrique à l’indépendance, y compris le Soudan ( actuel Mali).
Des énergies syndicales naquit le R.D.A.
Face à l’exploitation et à l’humiliation, la révolte ouvrière et paysanne va peu à peu s’organiser : Révolte bamanan de Diossé Traoré en 1915, celle des cheminots de Toukoto en 1919 ou encore celle de Kayes. Ces luttes ont été, le plus souvent, férocement réprimées. En 1921 le mouvement des cheminots sous la direction de feu Tiémoko Garan Kouyaté entraîna la déportation ou l’exil des « meneurs ». Ce n’est qu’après 1936 que les premiers syndicats sont autorisés avec beaucoup de restrictions.
Mais c’est vers les années 1944/1946 que la lutte syndicale s’organise. En 1946, les préoccupations syndicales vont désormais dépasser le cadre strict des revendications purement matérielles et se situer au niveau de l’homme tout entier dans ses fins propres, dans son esprit et dans son âme afin de le libérer de toutes ses servitudes. Le vote, le 5 avril 1946, de la loi mettant fin au travail forcé des africains a permis aux syndicalistes de prendre conscience de leurs forces.
C’est ainsi qu’ils vont se doter d’une structure politique à la mesure de leurs ambitions : le R.D.A. (Rassemblement Démocratique Africain.) qui a tenu son congrès constitutif à Bamako du 18 au 21 octobre 1946 dans l’enthousiasme général. Il y avait 800 délégués de différents pays : Côte-d’Ivoire, Guinée, Sénégal, Dahomey, Niger, Soudan, Cameroun et Tchad. Ce parti devait réaliser l’union des partis politiques des territoires français d’Afrique noire, et constituer ainsi un moyen de pression efficace contre l’autorité coloniale. Il va lutter pour amener les colonies françaises d’Afrique à l’indépendance. Il n’était pas d’ailleurs le seul, il y a eu le PAI ( Parti Africain pour l’indépendance).
Le PAI, né aussi des luttes syndicales
Le PAI (Parti Africain pour l’indépendance) est né dans le feu des luttes syndicales, notamment celles des cheminots de la ligne de chemin de fer du Dakar Niger en 1947-1948.
C’était le15septembre1957àThiès au Sénégal par un manifeste signé par vingt-trois patriotes africains originaires de la Guinée, du Mali, du Niger et du Sénégal.Ilsétaientprincipalementenseignants,médecins,pharmaciens,dentistes,fonctionnaires,ouvriers,ingénieurs,étudiantsetartistes.Organisé en sections territoriales, le PAI connu tensonseinunescissionaprèsl’éclatementdelaFédérationduMali.Unebonnepartierejoignitl’UnionSoudanaiseRDA (Rassemblementdémocratiqueafricain)defeuModiboKeitaavecquielleconstituacequ’onappelalaGaucheduRDAayantparticipéaucongrèsdu22septembre1960quiproclamal’indépendanceduMalietdécidadel’optionsocialistededéveloppement.Cettegaucheétaitfortementimpliquéedanslessyndicatsetlesorganisationsdejeunesse./.
Sidi Modibo COULIBALY