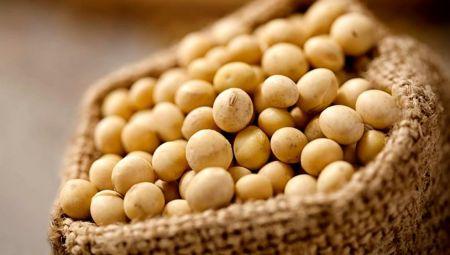Après plusieurs concertations, la BEAC a décidé de donner un délai supplémentaire aux entreprises pétrolières et minières pour l’application de la nouvelle réglementation de change, nous apprend Investir au Cameroun.
Concrètement, après deux premiers renvois, notamment au 1er septembre et au 10 décembre 2019, cette réglementation, officiellement entrée en vigueur depuis mars 2019, ne sera opposable aux entreprises pétrolières et minières en activité dans la Cemac qu’à partir du 31 décembre 2020.
Le gouverneur de la Beac, Abbas Mahamat Tolli (photo), a fait cette révélation le 18 décembre 2019 dans la capitale économique camerounaise, au sortir du dernier Comité de politique monétaire (CPM) de cette banque centrale, pour le compte de l’année 2019.
Pour rappel, l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation de change a été suivie par une pénurie des devises dans la zone Cemac, à cause du non-respect des règles par les banques commerciales. Des concertations entre ces établissements de crédit, les opérateurs économiques et la Beac ont abouti à la prise de mesures d’assouplissement, qui ont finalement permis de mettre un terme à cette crise des devises et de fluidifier les transferts internationaux.
Défis
Au demeurant, six mois après l’entrée en vigueur de cette réglementation, qui permet de mieux tracer la circulation des devises dans l’espace Cemac, les entreprises pétrolières et minières n’y sont toujours pas soumises. Et pour cause, ces dernières s’opposent à l’obligation de rapatriement des devises issues de leurs exportations, comme l’impose la nouvelle réglementation de change.
Ces entreprises, du fait de la particularité de leurs activités, bénéficient en effet de facilités accordées par les États de la Cemac, et qui leur permettent de ne pas rapatrier les fonds issus de leurs activités d’exportation.
Afin de trouver un terrain d’entente sur cette question, la Beac, tout en soulignant la nécessité pour tous de respecter les dispositions de la nouvelle réglementation de change (posture soutenue par le FMI), a engagé des concertations avec ces opérateurs pétroliers et miniers.
Selon les sources d’Investir au Cameroun, la banque centrale des États de la Cemac a d’ailleurs recruté un cabinet de renom, pour aider à la prise de décisions idoines et aux réajustements nécessaires devant conduire au respect de cette réglementation de change par les sociétés pétrolières et minières, sans que cela n’entrave le bon déroulement de leurs activités.
Brice R. Mbodiam