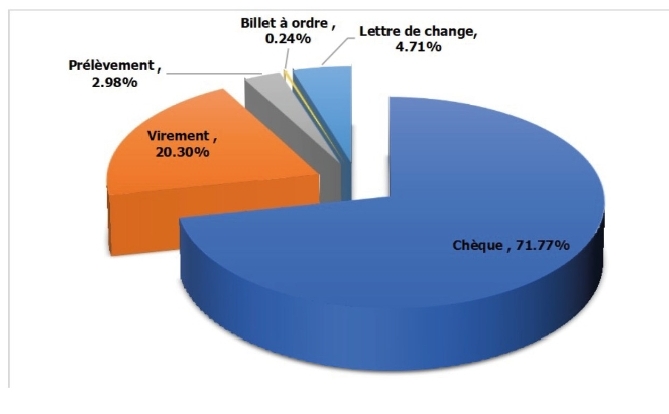(CROISSANCE AFRIQUE)-Le 18 août 2020 restera, sans conteste, une date mémorable dans l’histoire contemporaine du Mali. Ce jour-là, le pays a pris un tournant décisif qui allait redéfinir son destin. Cinq ans après, le constat s’impose : le Mali a connu des bouleversements majeurs, tant sur le plan institutionnel que sécuritaire, diplomatique, économique et social.
Sous la conduite du Général d’armée Assimi Goïta, la Transition, rectifiée et consolidée, a posé les jalons d’un Mali nouveau, plus souverain, plus résilient et résolument tourné vers l’avenir.
De la crise politique et sociale qui a culminé en août 2020 est née une volonté partagée : redonner au Mali sa dignité et à son peuple son espoir. Ce qui, pour certains, n’était qu’un fracas d’armes au camp de Kati, fut en réalité l’expression d’une aspiration profonde à la refondation. Cinq ans plus tard, il apparaît clairement que la Transition n’a pas été une simple période d’attente entre deux régimes politiques, mais une phase décisive de construction nationale et de réinvention de l’État.
En 2020, le Mali s’enlisait dans une spirale inquiétante. L’insécurité s’étendait, frappant aussi bien les régions du Nord que le Centre et menaçant le Sud. La corruption, gangrenant toutes les sphères de l’administration, affaiblissait l’État. La grogne sociale, portée par le Mouvement du 5 juin, Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), traduisait l’exaspération populaire face à un système à bout de souffle. La démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août 2020, suite à la décision du Général Assimi Goïta et ses compagnons, a ouvert une brèche historique. Une Transition, qui est venu à temps « parachever la lutte héroïque du peuple malien » et éviter au Mali un autre bain de sang, a alors été mise en place, d’abord conduite par Bah N’Daw, avant d’être rectifiée en mai 2021 par le colonel Assimi Goïta, devenu par la suite Général d’armée. Dès lors, un cap clair fut tracé : restaurer l’autorité de l’État, refonder les institutions et rendre au peuple malien sa fierté d’antan.
Une armée renforcée et souveraine
L’un des chantiers majeurs de la Transition fut sans nul doute la refondation des Forces de défense et de sécurité (FDS). L’armée malienne, longtemps décriée pour ses faiblesses logistiques et opérationnelles, a bénéficié d’une attention particulière. En cinq ans, des progrès considérables ont été réalisés : acquisition d’aéronefs de combat, de blindés, de systèmes de communication et de surveillance ; recrutement massif de soldats, policiers et agents de la protection civile renforçant la capacité opérationnelle ; ouverture de nouveaux centres d’entraînement axés sur la discipline et le professionnalisme ; déploiement accru des unités sur le terrain, traduisant la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa). Le départ progressif des forces étrangères, notamment françaises, a constitué un tournant symbolique et stratégique. Loin d’être un vide sécuritaire, il a été perçu comme un acte de souveraineté retrouvée, renforçant la confiance du peuple dans ses propres forces armées.
La corruption, longtemps considérée comme l’un des principaux fléaux du Mali, a été placée au centre des priorités. La Transition a fait de la bonne gouvernance et de la transparence des piliers fondamentaux. Le Bureau du Vérificateur Général (BVG), appuyé par des missions d’audit indépendantes, a mené des enquêtes approfondies. Des dossiers longtemps jugés intouchables ont été mis au grand jour : gestion des fonds Covid-19, utilisation de la Loi de programmation militaire, dépenses liées à la sécurité et à la défense, opérations immobilières douteuses de l’État, et même l’affaire emblématique de l’avion présidentiel. Pour la première fois depuis des décennies, des responsables de haut rang ont dû rendre des comptes. Cette dynamique a marqué une rupture avec l’impunité systémique, redonnant confiance aux citoyens dans la capacité de l’État à sanctionner les abus.
Au-delà de la sécurité et de la gouvernance, la Transition a mis l’accent sur la réforme de la Fonction publique. L’objectif était de mettre fin au clientélisme et garantir le mérite. Ainsi, les concours de recrutement ont été mieux organisés, sécurisés et digitalisés, limitant les fraudes et les interventions partisanes. Des milliers de jeunes Maliens ont ainsi accédé à des emplois publics sur la base de leur compétence et non de leurs relations. Ces réformes, en plus d’apporter plus d’équité, contribuent à redorer l’image de l’administration et à renforcer la confiance de la jeunesse dans l’État.
Le Mali maître de ses choix stratégiques
La Transition s’est également illustrée par une diplomatie audacieuse et souveraine. Le Mali, longtemps perçu comme sous tutelle internationale, a affirmé sa liberté de choix et sa dignité retrouvée. Parmi les décisions marquantes figurent le retrait des forces françaises et la fin de l’opération Barkhane, la sortie du G5 Sahel inefficace et déséquilibré, la renégociation des accords de défense pour les rendre équitables, la diversification des partenariats stratégiques, notamment avec de nouveaux alliés militaires et économiques, et l’expulsion de diplomates étrangers accusés d’ingérence.
Aussi faut-il noter la réorganisation sous-régionale sous l’impulsion des autorités de la Transition à travers notamment le signature de la Charte du liptako -Gourma et la naissance de la Confédération des États du Sahel (AES) et par ricochet le retrait de ce bloc de trois pays de la CEDEAO. Ces choix, parfois sources de tensions internationales, ont néanmoins été perçus comme l’expression d’une volonté ferme : placer les intérêts vitaux du peuple malien au-dessus de toute influence étrangère.
Il serait illusoire de penser que tous les problèmes ont été résolus. L’insécurité persiste encore dans certaines zones, la crise économique pèse sur les populations et les attentes sociales restent immenses. Cependant, il convient de reconnaître que la Transition a marqué une étape décisive dans le redressement du Mali. En cinq ans, l’image du pays s’est métamorphosée : de nation fragilisée et dépendante, le Mali est devenu un État affirmant ses choix, assumant ses responsabilités et traçant son chemin, avec l’aval et le soutien de son peuple.
Du 18 août 2020 au 18 août 2025, le Mali a écrit une page nouvelle de son histoire. Les réformes entreprises par le Général d’armée Assimi Goïta et son équipe de Transition constituent désormais un socle solide pour bâtir l’avenir. La refondation des FDS, la lutte contre la corruption, la réforme de l’administration, la souveraineté diplomatique, ainsi que les avancées en matière de gouvernance forment un héritage politique inédit. La Transition ne doit pas être perçue comme une parenthèse, mais comme une renaissance nationale, une rectification historique ayant permis au peuple malien de reprendre en main son destin.
Le 18 août 2020 fut le point de départ d’un long et difficile chemin. Le 18 août 2025, c’est l’heure du bilan, mais aussi celle de l’espérance. Cinq années de réformes, de luttes et de sacrifices auront permis au Mali de se redresser et de reprendre confiance en lui-même. Le Général d’armée Assimi Goïta et son équipe ont gravé dans l’histoire contemporaine du Mali une certitude : aucune nation ne peut se construire durablement sans souveraineté, sans justice et sans armée forte. L’avenir reste plein de défis, mais une chose est sûre : le Mali de 2025 n’est plus celui de 2020. Et cela, grâce à cinq années d’une Transition qui aura marqué au fer rouge l’histoire de la Nation.
Encadré :
Échec et mat pour les généraux traîtres et leurs sponsors internationaux !
Au moment où les autorités de la Transition, sous le leadership du Général d’armée Assimi GOÏTA, sont engagées sur tous les fronts pour redorer l’image de notre pays, sécuriser les populations maliennes sur l’ensemble du territoire national et œuvrer au renforcement de l’essor économique et du développement durable du Mali, une tentative de déstabilisation a été orchestrée. Deux officiers généraux, en compagnie d’un groupuscule de militaires, ont en effet cherché à saboter ses efforts à travers une opération dirigée contre les institutions de la République.
Cette manœuvre, largement soutenue et alimentée de l’extérieur, a bénéficié de l’appui de la France, dont un officier supérieur de la DGSE a été interpelé par nos services de renseignements. Grâce à la vigilance et à la réactivité de ces derniers, l’ensemble des instigateurs de cette entreprise de déstabilisation ont été arrêtés. Le plus surprenant demeure que les généraux Néma Sagara et Abass Dembélé, pourtant bénéficiaires de la considération constante des autorités de la Transition et du respect du peuple malien, n’ont pas hésité à trahir leur serment en se mettant au service de l’ennemi et des groupes terroristes, au détriment de leur propre patrie.
Rédaction