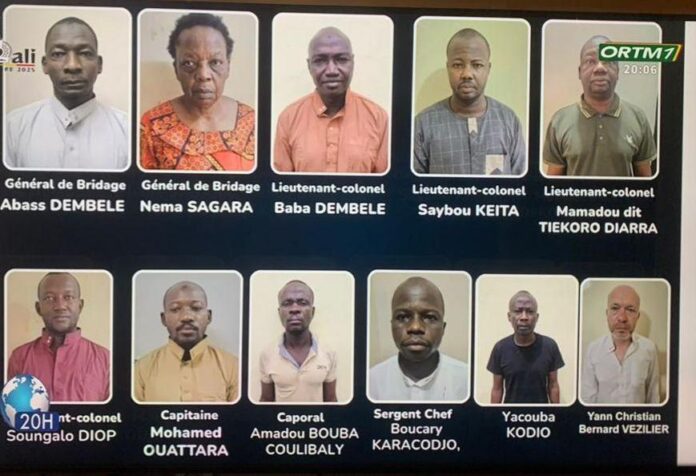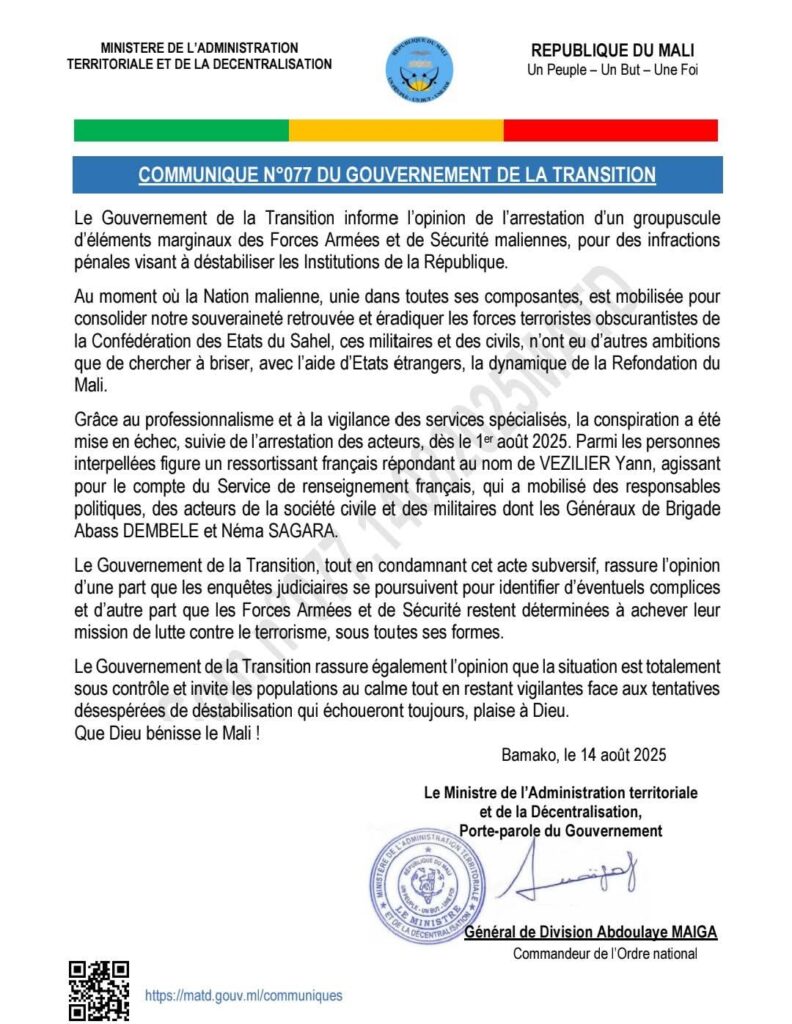(CROISSANCE AFRIQUE)-Au Liberia, l’importante entreprise agroalimentaire chinoise Mainland a exprimé son intention d’investir une somme substantielle de 100 millions de dollars américains, soit l’équivalent de 56 milliards de francs CFA, dans le secteur agricole du pays à partir de l’année 2025.
Cette initiative a été officiellement rendue publique par le biais d’un communiqué de presse diffusé sur le site officiel du ministère de l’Agriculture le mercredi 13 août. Le fonds considérable mis à disposition sera alloué à la mise en œuvre de divers projets ciblés couvrant pas moins de six segments d’activité agricole, dont certains incluent la transformation du manioc en amidon, la valorisation du cacao et du café par transformation, l’usinage approfondi du riz, le développement de la filière de production sucrière, ainsi qu’une amélioration significative de la logistique alimentaire.
Particulièrement prometteuse est l’annonce selon laquelle l’entreprise a des plans bien définis pour établir d’ici septembre ou octobre 2025 une usine spécialisée dans la transformation du riz sur une vaste étendue de 1 000 hectares située à Fuamah, localisée dans le comté de Bong. Ce développement industriel vise à améliorer considérablement l’accès des producteurs locaux aux marchés en facilitant la vente et la distribution de leurs produits.
Par ailleurs, la transformation du cacao est prévue pour débuter dès février ou mars de l’année suivante, dans le but d’ajouter de la valeur à cette ressource qui, pour l’heure, est principalement exportée sans traitement, sous sa forme brute, causant potentiellement une perte de revenus et de bénéfices pour l’économie locale, comme précisé dans le communiqué.
« Tous ces projets permettront d’augmenter les revenus des agriculteurs de 20 à 30 %. Notre objectif est d’impliquer plus de 150 000 producteurs au cours des cinq prochaines années. Dans cette optique, nous aspirons à instaurer une approche collaborative qui encouragera le partage de connaissances et de techniques parmi les producteurs, assurant ainsi une amélioration continue des méthodes agricoles. De plus, nous étendrons chaque année l’industrie et les plantations, en développant nos propres exploitations ainsi que celles des communautés locales, afin de favoriser un écosystème agricole durable et prospère », ajoute pour sa part M. Zhu Chen, PDG de Mainland.
Pour le groupe chinois, la réalisation de ces nouveaux projets au Libéria représente également une étape stratégique cruciale qui permettra d’étendre sa présence dans l’industrie agroalimentaire en Afrique.
Notons que ce secteur en pleine croissance offre des opportunités importantes, et Mainland, souhaitant se positionner comme un leader incontournable, exploite déjà 5 usines de traitement de caoutchouc naturel et une unité de traitement d’huile de palme en Côte d’Ivoire.
Depuis 2024, l’entreprise a également élargi ses opérations en inaugurant une unité de production d’huile de tournesol en Tanzanie, ce qui témoigne de ses ambitions d’expansion rapide et de son engagement envers l’excellence dans le domaine agro-industriel sur le continent africain. Ces efforts sont également orientés vers le renforcement de la capacité économique des partenaires locaux et la stimulation de la croissance économique régionale.
Mariam KONE