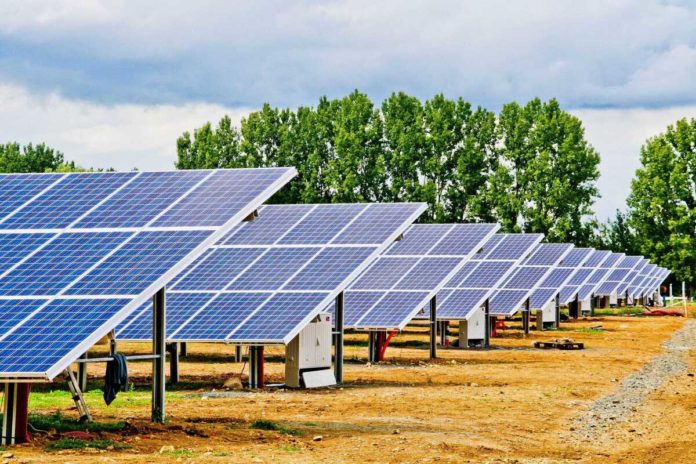(CROISSANCE AFRIQUE)-La fintech égyptienne Valu a franchi une étape majeure en levant 22 millions USD, marquant ainsi un tournant significatif dans son développement.
Cette opération a été réalisée grâce à la finalisation de sa quinzième émission d’obligations titrisées, représentant un montant impressionnant de 1,036 milliard de livres égyptiennes (EGP). Cette initiative, orchestrée par EFG Hermes, l’une des institutions financières les plus respectées de la région et une filiale d’EFG Holding, témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans les solutions financières innovantes proposées par Valu.
Ce dernier s’inscrit dans un programme de titrisation récemment approuvé, d’une valeur totale de 16 milliards d’EGP, qui vise à soutenir la croissance des entreprises en offrant des options de financement plus accessibles. La titrisation révolutionnaire mise en œuvre par Valu ne se limite pas à transformer des actifs sous-jacents en titres précieux, mais elle permet également de dynamiser l’écosystème entrepreneurial égyptien.
En fournissant aux petites et moyennes entreprises (PME) un accès facilité aux capitaux, Valu joue un rôle clé dans la stimulation de l’innovation, créant ainsi un environnement plus favorable à l’émergence de start-ups dynamiques. De plus, cette approche augmente la liquidité sur le marché, attirant non seulement des investisseurs locaux mais également étrangers, et consolidant ainsi l’Égypte comme un hub incontournable pour la fintech en Afrique du Nord.
En permettant aux PME d’accéder à des capitaux nécessaires, Valu contribue à l’essor entrepreneurial en Égypte, un pays qui a besoin de diversification économique et d’innovation. Cette démarche renforce la position de Valu comme un catalyseur d’une finance inclusive, où de nombreuses entreprises, traditionnellement sous-financées, pourront enfin émerger et prospérer.
Notons que le fait que cet événement se produise dans un climat d’incertitude économique globale accentue l’importance de cette avancée. L’initiative est non seulement cruciale pour Valu, mais elle souligne également le potentiel croissant du secteur fintech en Égypte, qui attire l’attention des investisseurs locaux et internationaux désireux de capitaliser sur le dynamisme économique de la région.
Abdoulaye KONE