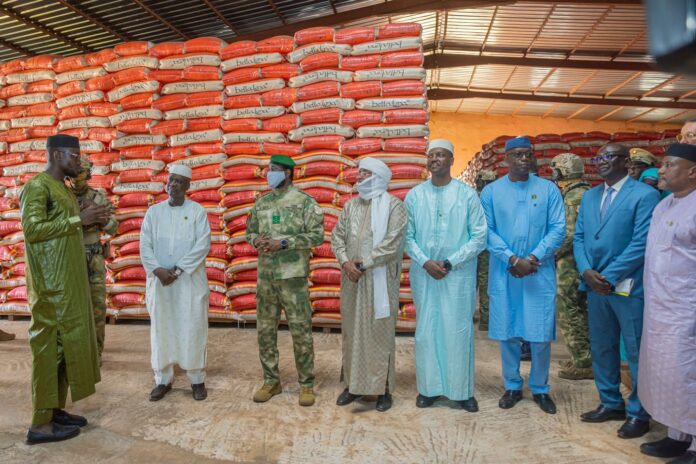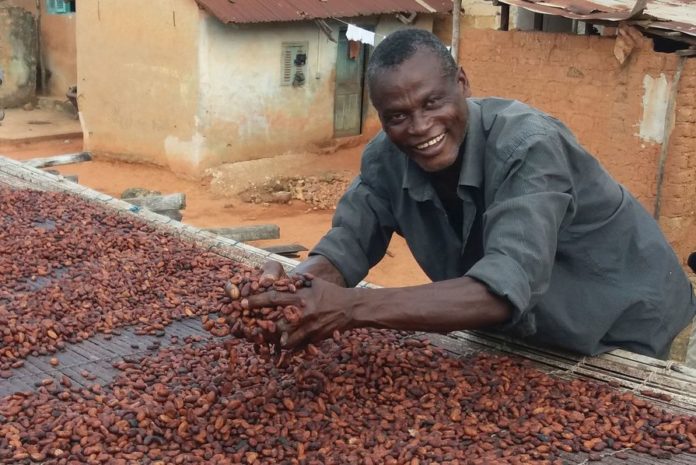Réplique de clarification d’une équipe soudée
Face à une campagne médiatique ourdie contre l’ancien premier Choguel, son équipe de communication a jugé utile et nécessaire d’apporter quelques clarifications.
- Depuis plusieurs jours, une campagne médiatique à outrance, bat son plein dans les Journaux, les radios, les TV et sur les réseaux sociaux, autour des conclusions du rapport du BVG (Bureau du Vérificateur Général) relatif à la vérification financière et de conformité de la Primature : Exercices 2021, 2022, 2023, 2024 (30 novembre).
Même l’IA (intelligence artificielle) est mise à contribution, sur des pages YouTube dédiées, comme par exemple, cette vidéo sur YouTube, dont l’auteur réside en France et les serveurs, installés aux Îles Canaries. Comme par hasard, il faut aussi noter la présence de « panafricanistes » à Bamako et sur les réseaux sociaux au même moment de cette campagne médiatique. Des Journalistes occidentaux et d’autres médias africains s’en mêlent, parfois en diffusant, et de façon répétitive, beaucoup de désinformation. Bref, on sent que l’objectif recherché est de faire peur à tout le monde, de faire comprendre à tous que désormais rien n’est impossible au Mali, et par la même occasion réduire l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga au silence et l’humilier !
De quoi s’agit-il exactement ?
- La mission de contrôle du BVG a démarré à la Direction Administrative et Financière (DAF), le mercredi 27 novembre 2024, soit cinq (5) jours, après la passation de Service entre les Premiers ministres sortant et entrant, le 22 novembre 2024. La vérification a été initiée sur saisine.
- Le Vérificateur général (VEGAL) a transmis au Cabinet du Premier ministre ses constatations liées aux dépenses sur le Filet social.
En principe c’est le Cabinet du Premier ministre qui devrait répondre. Au lieu de cela, le Directeur de Cabinet du Premier ministre a transmis le dossier au Directeur Administratif et Financier (DAF), suivant le Bordereau d’envoi numéro 0067/PRIM-CAB du 9 avril 2025 pour « éléments de réponses en rapport avec les personnes concernées ».
C’est dans ce sens que le DAF de la Primature a transmis à l’ancien Premier ministre Choguel, le 22 avril 2025, les constatations liées aux dépenses sur le Filet social pour ses éléments de réponse. - La vérification de la gestion de la Primature est ciblée, elle concerne exclusivement la gestion de l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. En effet, elle est effectuée sur la base d’une saisine, tout juste après la passation entre les Premiers ministres sortant et entrant. La période d’intérim occupée par l’actuel Premier ministre (août 2022 décembre 2022) a été occultée, mettant en cause la représentativité des échantillons ayant servi à la formulation des constatations.
- Un autre aspect c’est l’imputation de la gestion de certaines activités des six (6) premiers mois de 2021, à l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, une période antérieure à sa nomination comme Premier ministre. A titre illustratif, le rapport lui reproche la « Prise en charge de l’appui du Gouvernement à la Fondation Forum de Bamako pour l’organisation de la 21ème édition du Forum de Bamako », pour un mandat établi le 3 mai 2021. L’ancien Premier ministre a pris fonction le 7 juin 2021. Trouvez l’erreur !
A) Sur le fond du Rapport :
Sur le Filet social, le constat du rapport porte sur des décisions de mandatement signées par le Directeur de Cabinet, l’exécution de dépenses non éligibles.
Ce qui est reproché ici ne constitue pas des dépenses inéligibles sur le Filet social, dans la mesure où il n’existe pas une liste règlementaire (nomenclature) de dépenses liées au Filet social.
En conséquence, les dépenses sur le Filet social sont faites à la discrétion du Premier ministre. C’est ainsi qu’il en a été, sous tous les Premiers ministres qui se sont succédé au Mali. De surcroit, aucune loi ou texte n’encadre la gestion du Filet social. Chaque Premier ministre a géré le Filet social à sa discrétion.
- Quand une dépense est inéligible, ce sont les spécialistes en la matière (comptable, trésorier payeur) qui rejettent les mandatements, or, aucun mandat n’a fait l’objet de refus de paiement de leur part.
- Pour qu’un constat soit pertinent, il faut qu’il viole un texte de loi ou une norme qu’il faut préciser. En effet, la conclusion du Rapport final du Vérificateur général (page 22) recommande : « … Le Filet social gagnerait aussi à être mieux encadré ».
. Au titre des fonds de Souveraineté, le constat fait est le paiement irrégulier de dépenses de Souveraineté au Premier ministre.
- Ici aussi le constat est battu en brèche. Le paiement des dépenses de Souveraineté lors des missions du Premier ministre n’est pas irrégulier.
En effet, l’article 5 du Décret n°2016-001/P-RM du 15 janvier 2016 fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’indemnité de déplacement et de mission stipule : « les missions effectuées à l’intérieur et à l’extérieur par le chef de l’État et le Premier ministre font l’objet d’une prise en charge totale sur la base d’un budget présenté au Ministre chargé du Budget ». - Toutes les missions qui ont été effectuées par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga et même par les autres Premiers ministres, avant et après lui, ont été effectuées sur la base de l’article 5 susvisé. Les requêtes d’avances de trésorerie adressées par le Directeur de Cabinet du Premier ministre au Ministre de l’Économie et des Finances (MEF) sont toujours accompagnées par un budget incluant une ligne relative aux dépenses de souveraineté (frais de souveraineté), lors desdites missions. En conséquence, la Direction Administrative et Financière (DAF) exécute les dépenses de mission du Premier ministre à l’intérieur et à l’extérieur conformément au budget joint à la requête. Le décret précité ne donne pas de précision sur la nature ou la catégorie de dépense du chef de l’État ou du Premier ministre qui sont à prendre en charge dans le cadre de leurs missions à l’intérieur et à l’extérieur du Mali.
B) Observations :
. Il y a lieu de préciser que les vérificateurs à ce niveau ont confondu frais de mission (qui concernent les fonctionnaires et les autres) et budget (qui concernent le Chef de l’État et Premier ministre).
- Comme relevé par les vérificateurs dans leur Rapport final, il n’existe ni textes qui indiquent à quelles autorités, les dépenses de Souveraineté doivent être payées, ni textes qui fixent son montant par bénéficiaire.
- Le cadre juridique des dépenses de Souveraineté du Premier ministre, basé sur le Décret N°0001/P-RM et la Loi N° 2013-028, justifie l’engagement des dépenses, sans limitation explicite. Le rôle du Ministre de l’Economie et des Finances (MEF) est central dans la régularisation budgétaire, tandis que la DAF de la Primature n’a qu’un rôle d’exécution. Les critiques du BVG sur le caractère « indu » des dépenses ou le rôle de la DAF semblent mal fondées au regard des textes, que le Rapport a évoqués.
Ceci nous amène à nous poser la question : sur quoi les vérificateurs se fondent pour parler d’irrégularités ? - Choguel affirme souvent « qu’il y a des plats qu’on ne mange pas, même quand on a faim ! »
Choguel a réaffirmé, plusieurs fois et régulièrement, qu’il a une confiance pleine et entière en ses Collaborateurs et en la Justice malienne ! - Pour le reste Choguel ne s’occupe pas des détails de la gestion financière de la Primature. Tout ce que ses Collaborateurs ont posé comme actes de gestion s’est fait exclusivement en conformité avec ses instructions et les lois et règlements du pays.
Voilà ce qui a valu dans les médias cette campagne contre la personne de l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.
D) Choguel victime de tous les pouvoirs politiques qu’il a servis avec loyauté, dans l’intérêt supérieur du Mali.
- Dommage pour les acteurs de toutes les campagnes médiatiques hideuses et insidieuses contre Choguel, car il n’est pas de cette engeance d’acteurs politiques qui ont peur. Sinon, il n’aurait pas soumis une demande de récépissé en 1993 pour la création d’un Parti politique, au moment où beaucoup de ceux qui avaient profité du pouvoir de la 2ème République avaient, soit rejoint les princes du jour, soit étaient rentrés sous le lit.
- Choguel a clairement le sentiment que cette action ne va pas dans le sens de l’intérêt supérieur du Mali. En effet, chercher des poux sur une tête rasée se révèle être une tâche très compliquée, sinon tout observateur honnête et averti de la situation politique du Mali de 2021 à 2024, sait que Choguel ne se reproche absolument rien de ce que certains prétendent être un acte de détournement de deniers publics. Il a une entière confiance en ses Collaborateurs et en la Justice malienne ! Pour le reste, le rapport ne peut rien contenir techniquement de crédible. Il est politique et résulte d’une manipulation, voire d’un acharnement.
- Pour rappel, Choguel a déjà connu par le passé des situations similaires. En effet, tous les pouvoirs politiques au Mali auxquels il a participé au Gouvernement ou à la gestion, et même avant le 26 mars 1991 quand il était un simple membre du Bureau Exécutif National de l’UNJM, ont essayé de le salir et le réduire au silence et l’humilier, chaque fois qu’il a simplement formulé des opinions divergentes ou qu’il a refusé la compromission ou l’allégeance.
- Déjà le vendredi 22 mars 1991, Choguel fut convoqué à la Sécurité d’État, pour la deuxième fois, essentiellement pour s’expliquer sur certaines de ses prises de position politiques, que des personnes (en fait des adversaires politiques infiltrés au sommet du pouvoir en place !) considéraient comme hostiles au Gouvernement. Mais à cause des troubles qui avaient éclaté ce jour-là (le 22 mars 1991), sa convocation a été remise au mardi 26 mars 1991, un rendez-vous qui n’aura jamais lieu, parce qu’entre-temps, les adversaires avaient eu raison du pouvoir en place qui a basculé.
- De 2002 à 2024, Choguel a été soumis à neuf (9) missions de contrôle et de vérification de sa gestion. Cela se passait presque toujours quand il était en fonction et/ou immédiatement après la fin de sa mission et la passation de Service. Il en était ainsi :
a) une (1) fois en 2007 après son passage au Ministère de l’Industrie et du Commerce (immédiatement après la passation de Service à la fin de sa mission de Ministre);
b) deux (2) fois en 2011 et 2012 à l’AMRTP pendant qu’il y était Directeur Général en fonction ;
c) deux (2) fois en 2015 à l’AMRTP pendant qu’il était Ministre de la Communication et l’Économie numérique, Porte-parole du Gouvernement. En cette période également, le pouvoir en place avait choisi un Journal du nom de “Info Sept”, qui était mobilisé pour organiser, chaque semaine, un puissant lynchage médiatique de Choguel ; ce Journal était alors dirigé et animé par un militant politique notoirement engagé contre Choguel ;
d) deux (2) fois en 2016 au Ministère de l’Économie numérique et de la Communication, immédiatement après la fin de la mission de Choguel et la passation du Service ;
e) une (1) fois en 2023 pendant que Choguel était encore Premier ministre et Chef du Gouvernement de Transition en fonction ;
f) et cette fois-ci, en novembre 2024, cinq (5) jours après la fin de la mission de Premier ministre et la passation du Service.
Mais, comme on le dit, l’agenda des Hommes est différent de l’agenda de Dieu !
- Si en 2025 encore, certaines personnes et dirigeants politiques pensent, inventer la roue de l’Histoire, ils se trompent lourdement ! En tout cas, en ce qui concerne Choguel.
- Dans certains pays en Afrique en général, au Mali en particulier, chaque fois qu’il s’agit d’un leader politique, dans une telle situation, les gens se posent invariablement la question suivante : qu’est-ce qui va lui arriver ? Les gens s’intéressent moins, ou pas du tout, de savoir si ce qui lui est reproché est vrai ou pertinent. Ainsi, la gouvernance se fait par la peur, l’humiliation, la prison ou les menaces de terreur et de mort.
- Les vrais responsables politiques et les Maliens patriotes, n’abdiqueront jamais. Certes, ils emprunteront des voies différentes, mais ils se battront pour l’émancipation de notre pays et du Peuple malien. Ils se battront jusqu’à notre émancipation totale et l’aboutissement des justes revendications du Peuple malien.
- Le constat est que, malheureusement, les structures et missions de contrôle et de vérification de la gestion des différentes entités nationales, sont utilisées par les tenants du pouvoir et/ou leurs proches, pour faire du chantage et des pressions politiques.
Dommage pour le Mali, que les mêmes pratiques continuent, surtout après le Changement intervenu en août 2020 mais aussi et surtout après la Rectification du 24 mai 2021 ! - Pour ceux qui l’ont oublié ou qui ne le savent pas, dans les années 1993, 1994, 1995, 1996, des acteurs politiques et des journalistes, dont certains sont encore en vie, avaient appelé publiquement, à s’attaquer à l’intégrité physique de Choguel Kokalla Maïga et de sa famille. Il a dû “exiler” sa famille au village, et vivre, seul, en “exil intérieur”, ici au Mali, à Bamako, pendant des années…
- Hélas, Choguel continue, aujourd’hui, encore de subir les mêmes violences physiques et morales !
Pour lui, seuls comptent les intérêts supérieurs du Peuple malien et les perspectives par rapport à la Grande Histoire du Mali.
Il est convaincu que chaque personne suit son destin, inexorablement !
Il est écrit : « Dis : Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu’Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C’est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. » (Sourate At-Tawba, 9:51)»
Dieu fera le reste du travail !
Bamako, le 3 aout 2025
Équipe de Communication de l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maiga