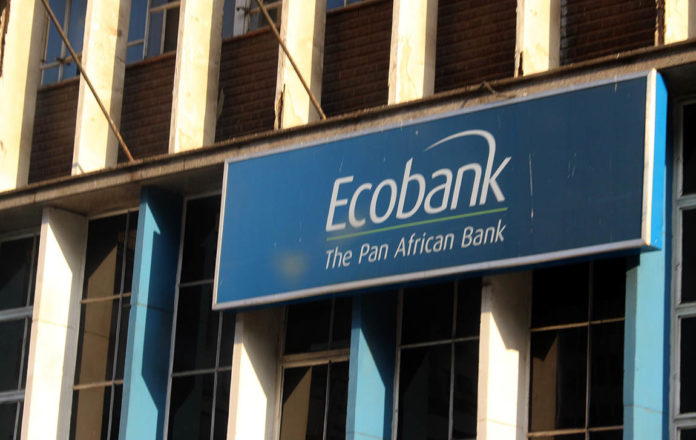(CROISSANCE AFRIQUE)-Lenrichissement illicite des agents publics au Mali est un phénomène récurrent de l’indépendance à nos jours. C’est un frein au developpement du pays. Il semble être systémique puisqu’il touche tous les démembrements de l’administration publique, ainsi que des collectivités territoriales.
Avec l’avènement de la transition politique actuelle, d’importants efforts ont été déployés pour endiguer le phénomène. Et pour mieux le combattre, il fallait comprendre les techniques par lesquelles il se réalise.
Tous les régimes politiques successifs ont connu le phénomène, mais à des degrés différents. Si sous la première République (1960-1968), les agents avaient honte de détourner l’argent public pour ne pas perdre leur honneur et leur dignité ; pendant la seconde (1968-1991), ils avaient peur de le faire à cause des sévères sanctions judiciaires. Par contre sous la IIIème Republiquen(1992-2020), ils en ont fait une pratique « à ciel ouvert » et étaient même vus comme des exemples de réussite et d’ascension sociales. En 2021, l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI), dans un rapport issu d’une étude qu’il a commanditée, a dévoilé les techniques de détournement des fonds publics ainsi que les manœuvres utilisées pour les dissimuler. D’après le rapport, il faut entendre par « techniques » les pratiques au moyen desquelles des agents publics senrichissent illégalement au détriment de lEtat. Ce sont les pratiques corruptives ; la lenteur procédurière et la création de file dattente ; le Dédoublement de ladministration publique ; la Prise illégale dintérêt ; la Surfacturation ; la Fraude (en matière des examens et concours, fiscale, douanière, électorale, informatique, etc.) ; les Atteintes aux biens publics ; le Faux et usage de faux ; le Délit dinitié ; lUsurpation de titre ou de fonction ; lOctroi davantages sans base légale.
Les pratiques corruptives
Les pratiques de corruption sont des pratiques des pots-de-vin qui se réalisent à travers la rétrocession illicite, le paiement de facilitation (pour diligence); la mauvaise prise en charge de l’usager pour l’amener à payer pour un service public gratuit ; l’accès à certains lieux ou autorités publics contre paiement dune somme dargent ; le paiement dune somme dargent par les détenus pour accéder à une chambre de détention plus confortable. Il y a aussi la commission illicite qui se caractérise par l’acceptation dargent par un agent pour influencer l’attribution dune commande publique, la fixation dun pourcentage du montant du marché à payer, l’acceptation de fausses déclarations (impôts, douanes), la gratification illégale, la concussion/rétribution indue de service, le trafic d’influence (utilisation de la position élus politiques pour démarcher les services de l’état en vue de bénéficier des marchés publics), l’usage de l’influence par les autorités publiques pour l’obtention des marchés, le recrutement du personnel, l’acceptation de dossiers irréguliers de candidature aux postes électifs, le détournement de suffrages, labus d’autorité ou de pouvoir.
D’autres pratiques corruption sont également annoncées dans le rapport telles que le favoritisme qui se manifeste à travers le fractionnement des marchés, l’attribution illégale de marchés de gré à gré, l’octroi de promotion à un agent ne remplissant pas les critères, agents publics dirigeant des Associations/ONG/fondations à travers leurs proches pour leur octroyer des marchés et ainsi bénéficier des avantages de ces structures sous forme de revenus additionnels non déclarés, l’accord entre les membres de la commission d’appel d’offres pour favoriser une entreprise afin quelle soit attributaire du marché public, l’extorsion/racket/chantage, etc.
La fraude
La fraude est perceptible en matière des examens et concours, fiscale, douanière, électorale, informatique, etc. En d’autres termes, il s’agit de la vente des sujets ou laisser les candidats tricher lors des examens et concours contre le paiement dargent, du redressement des contribuables puis négociation en faveur de ces derniers avec paiement de pots-de-vin aux agents publics, de la minoration des droits à payer. Il y a aussi la fraude en faveur de partis politiques ou des candidats par les personnes chargées de l’organisation, de la supervision et du contrôle des élections moyennant le paiement des pots-de-vin ou autres avantages ; et la fraude relative à la modification, suppression, altération des données informatiques dans le cadre des malversations diverses.
Les atteintes aux biens ou publics
Quant aux atteintes aux biens publics, elles sont relatives au règlement des prestations non effectuées par les entreprises et les fournisseurs ; à la réutilisation des documents d’achats (double emploi) ; au détournement de certaines valeurs (tickets, carburant); au détournement par la non récupération des avances accordées aux fournisseurs ; à la Soustraction de biens du patrimoine de l’entreprise, sortie articles en stocks ; à la dépréciation des stocks ; à l’existence d’agents fictifs émargeant sur les états de salaire ; au détournement de recettes publiques (droits et taxes) ; au détournement par le biais des caisses avances ; à la signature daccord d’établissement ou autres documents au niveau de certains services publics afin de rendre légal des avantages indus.
Le faux et usage du faux
En ce qui concerne le faux et usage de faux, il se manifeste à travers lacceptation des élèves ayant épuisé leur cycle scolaire depuis des années comme candidats réguliers ; la falsification de documents financiers (mandats, chèques) ; létablissement de fausses signatures, de faux diplômes et de faux documents détat civil et didentification, de faux quitus fiscaux, de faux cadastres, de fausse attestation bancaire et caution sur marchés, de faux curriculum vitae, de fausses capacités techniques, de faux procès-verbaux, de faux bordereaux de livraison, etc. ; limitation de signatures ; les fausses écritures destinées à couvrir un détournement.
La liste des techniques n’est point exhaustive. On retrouve dans le rapport des manœuvres de subtilisation d’argent comme la lenteur procédurière et la création de file d’attente ; le dédoublement de l’administration publique ; la prise illégale d’intérêt ; et la surfacturation (facturation abusive) : augmentation frauduleuse des prix des matières ou des services lors de la commande publique.
Avec ces techniques, les caisses de l’État ont été sérieusement pillées par ceux-là mêmes qui devraient en être les gardiens. Le cas de six (6) fonctionnaires cité dans le dernier rapport annuel du Bureau du Vérificateur général est très illustratif. A eux seuls, ils totalisent des revenus annuels de 1 877 080 560 FCFA. Ce qui dépasse de très très loin leurs revenus légitimes qui se chiffrent à 335 375 781 F CFA. C’est un constat fait uniquement à travers les entrées sur leurs comptes bancaires et de finances mobiles.
Notons que les biens en nature n’en font pas partie. Donc, ce n’est point un hasard, qu’en 2021, Transparency International sur L’indice de Perception de la Corruption (IPC) ait classé le Mali au rang de 7ème sur les huit (8) de la zone UEMOA (Union monétaire ouest-africaine) après la Guinée Bissau. Autrement dit, le Mali se classe comme deuxième pays, après la Guinée Bissau, de l’espace UEMOA dans lequel l’enrichissement illicite est le plus criard./.
S M C