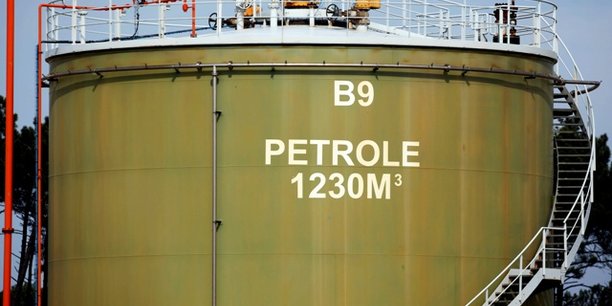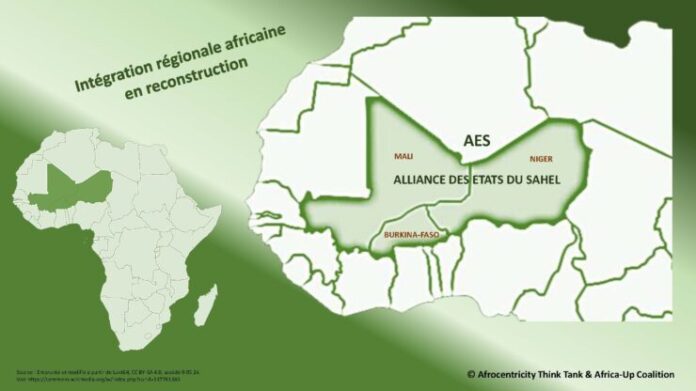Image: Google (Cominita di Sant’Egidio)
(CROISSANCE AFRIQUE)-Dans un contexte marqué par l’instabilité sécuritaire, les contestations politiques, les difficultés économiques, les revendications sociales, les conflits intercommunautaires et la propagation croissante des fausses informations fragilisant ainsi le tissu social, l’éducation à la paix dans les familles maliennes s’impose comme un pilier essentiel pour bâtir une société plus résiliente et réconciliée.
Au Mali, cette mission ne saurait être confiée uniquement à l’école, aux institutions religieuses ou aux ONG. Les parents – premiers éducateurs – ont un rôle central, irremplaçable, dans la transmission des valeurs de paix, de tolérance et de dialogue.
Comme l’affirme Mme Traoré Claire Coulibaly, parent, être parent implique d’être à la fois enseignant et éducateur. Chaque démarche éducative devrait passer par l’information, la sensibilisation, la concertation et le dialogue.
Lorsque ces actions échouent, la sanction devient une option. Au sein de la famille, il est crucial d’inculquer aux membres que la paix est synonyme de tranquillité et de sérénité, c’est-à-dire d’absence de violence, de conflit, d’intolérance et de guerre. La tolérance est une vertu indispensable pour maintenir la paix. Il est essentiel de fournir des informations véridiques, car la désinformation incite à la violence.
« Dans la famille, chaque membre doit donner l’exemple par des actes de vie positifs. Un parent se doit d’être modèle en cultivant la tolérance, la justice, l’esprit de partage et de pardon, tout en rejetant l’exclusion et en sanctionnant lorsqu’il est nécessaire. La vérité doit être au cœur des valeurs familiales car une maison fondée sur le mensonge est vouée à l’échec », ajoute Mme Traoré.
L’ enseignement des droits humains.
Pour elle, il est important de mettre en place d’autres stratégies, telles que le dialogue franc, la diffusion d’informations vérifiées, la promotion du respect mutuel et l’acceptation des différences, tout en évitant l’égoïsme.
Mme Sidibé Lucienne Keïta, présidente de l’Association des Femmes Catholiques, mère de famille, insiste sur l’importance d’un dialogue constant au sein de la famille, en affirmant que les parents doivent s’engager dans des échanges ouverts devant leurs enfants. « Faire preuve d’humour facilite la communication et permet de mieux comprendre leurs enfants. Cela offre également l’opportunité de corriger les fausses informations », ajoute-t-elle.
Elle souligne l’importance de sanctionner les querelles et les comportements violents, tout en éduquant les enfants à la diversité culturelle, par exemple en les faisant participer à des travaux auprès des voisins, quelle que soit leur confession.
La participation aux tâches ménagères renforce également la solidarité entre les enfants. Il doit également y avoir des discussions ouvertes sur l’actualité et la diversité culturelle, où les conflits sont résolus sans cris ni violence envers les enfants. Impliquer les enfants dans les décisions dès leur jeune âge est impératif.
L’unité et l’ouverture du couple, une école pour la non-violence.
En ajoutant que l’unité entre le mari et la femme constitue une école silencieuse très puissante, ce couple âgé insiste sur l’exemplarité parentale. Youssouf Koné et sa femme, un jeune couple, déclarent qu’ils prônent la non-violence : « nous sommes des parents très patients qui privilégient l’échange. Nous évitons de crier et nous posons beaucoup de questions, de manière à ce que nos enfants ne ressentent pas de peur à notre égard. Nous nous efforçons de leur inculquer la culture de la paix ».
Q
Dans une famille monoparentale, Mme Fatou Traoré, veuve, évoque la stratégie qu’elle met en œuvre depuis le décès de son mari. « Mon mari, de son vivant, était quelqu’un de pacifique et ouvert avec les enfants. Depuis son décès, j’intensifie mes efforts pour préserver les valeurs qu’il leur a enseignées. Parfois, je succombe à la violence, mais je m’efforce toujours de suivre ses méthodes axées sur le dialogue et le partage ».
L’exemplarité et le devoir parental
Mme Sidibé, également présidente de l’Association des Femmes Catholiques du Mali, souligne que la Bible enseigne la tolérance et le vivre-ensemble. Selon elle, ces valeurs sont inculquées aux enfants dès le catéchisme, afin de les préparer à devenir de bons adultes et des messagers de paix. Le leader musulman Mohamed Diabaté insiste aussi sur l’exemplarité des parents pour l’éducation à la paix.
« En Islam, l’exemple des parents est primordial. Les valeurs comme la miséricorde, le dialogue, le pardon et la tolérance doivent être transmises dès le plus jeune âge, afin de faire d’eux des acteurs de la paix, non seulement dans la famille, mais également dans la société ».
Il ajoute que, conformément à l’islam, les parents doivent inculquer à leurs enfants la bienveillance et l’assistance envers autrui, car la diversité est une richesse. « Enfin, il est essentiel d’enseigner aux enfants que Dieu est miséricordieux et aime ceux qui font preuve de miséricorde, comme précisé dans les hadiths ».
Sekouba Tassolo Traoré, un traditionaliste, met également en avant l’importance de la droiture du chef de famille, qui doit transmettre des valeurs telles que le respect des autres et la morale aux enfants. Il soutient que la famille doit travailler ensemble pour éviter les conflits et que la soumission du plus jeune envers l’aîné est cruciale.
En conclusion, une famille qui incarne ces valeurs est une famille dans laquelle règne la paix.
D’après le Sociologue Mohamed Guindo, chaque ethnie au Mali aspire à la paix, attestant que « la paix est universelle. Dans chaque communauté, on retrouve une culture unique qui doit être transmise.
L’éducation doit s’enraciner dans la culture, par exemple à travers l’apprentissage de la langue maternelle, qui est le véhicule de cette culture ».
La responsabilité des parents est incontournable. Si chaque famille éduque dignement ses enfants, la paix pourrait de nouveau régner dans nos foyers.
Notons que ce constat commun aux leaders religieux, traditionnels et sociologue évoque l’importance de cultiver la paix en famille à travers le dialogue, la tolérance et le respect mutuel, contribuant ainsi au tissu social précieux de notre société. La paix peut réellement être considérée comme universelle.
Kadidia Doumbia
(Ce reportage est publié avec le soutien de Journalistes pour les Droits Humains (JDH) au Mali).